- Laure Saincotille
- 26/11/2024
En France, depuis plus de soixante ans, la notion d’« autonomie » fait son chemin dans le vocabulaire de l’action publique. La création de la cinquième branche de la sécurité sociale, la branche « Autonomie », est le témoin majeur le plus récent de la progressive installation de ce terme et des projets socio-politiques dont il est porteur. Il s’agit pourtant d’une notion plurielle, qui reste floue, et dont l’usage est contesté par de nombreux acteurs du champ ainsi que par les personnes dont « l’autonomie » est en question. Cette septième séance du séminaire « Autonomie(s) » s’intéresse aux processus d’institutionnalisation de cette notion dans le champ de l’action publique française et aux réactions contrastées que celle-ci a engendré. Bonne lecture !
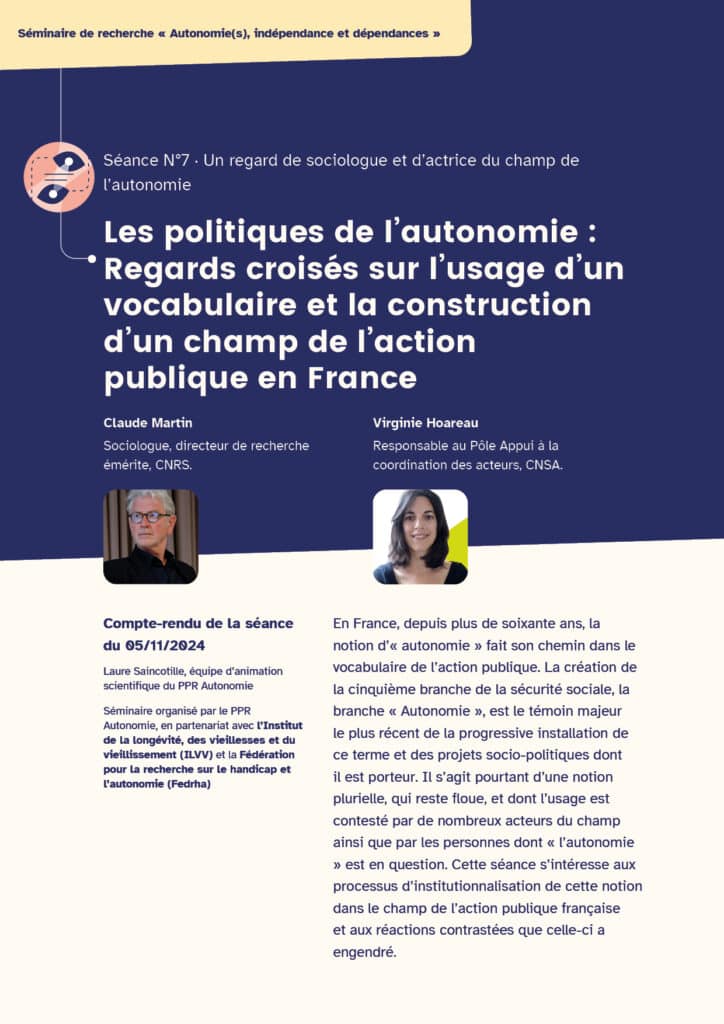
De la dépendance à l’autonomie, petite généalogie d’un secteur de l’action publique et sociale – Claude Martin
L’autonomie est un concept qui connaît un grand succès dans les secteurs de l’action publique, tout en étant critiqué pour être en phase avec les politiques néolibérales et pouvoir aisément servir d’injonction à la mise en conformité des individus. Il convient donc d’être attentif à ces critiques lors de la construction des politiques publiques de l’autonomie en France.
Entre 1970 et 2000, c’est le vocabulaire de la « dépendance » qui prévaut dans le secteur de l’action et de la protection sociale en France. Le grand âge et le handicap sont alors liés aux « incapacités » et observés dans une perspective curative.
« L’idée qui s’impose est celle selon laquelle il faut tout faire pour soutenir, dans les actes de la vie quotidienne, les personnes avançant en âge ou en situation de handicap. La notion de « soutien par un tiers » devient également prédominante. »
Pendant ces trois décennies, une réflexion est menée sur les prestations monétaires devant permettre ce soutien – à destination des personnes dites « dépendantes » ou à destination de leurs proches-aidants. Dans les années 1980, du fait de l’allongement de l’espérance de vie, on s’inquiète de l’explosion du coût de la prise en charge des besoins des personnes âgées dépendantes. Dans les années 1990, une série de réflexions, de dispositifs expérimentaux et de mesures sont avancés : discussions à propos de l’attribution aux personnes âgées de l’allocation compensatrice pour tierce personne, développement de la prestation expérimentale dépendance, création de la prestation monétaire spécifique dépendance, débats sur les modèles d’évaluation de la dépendance et évocation de l’hypothèse du « cinquième risque ».
C’est au début des années 2000 que la notion d’autonomie s’impose, à la faveur de la réforme APA (Allocation personnalisée d’autonomie). Cette réforme est ainsi décrite :
« entre aide sociale et universalité, avec l’idée d’universalisme proportionné (tout le monde a le droit à quelque chose selon ses ressources, avec l’idée de ticket modérateur ou de reste à charge) vise à dépasser les limites de la PSD, et supprime un certain nombre de freins. »
La population des bénéficiaires de cette aide est ainsi mieux cernée et mieux prise en charge dans ses besoins. L’adoption de la notion d’autonomie, en remplacement de celle de dépendance, tend à faire changer les représentations à l’égard du grand âge, moins perçu comme une période d’incapacité toujours croissante.
Le débat sur le cinquième risque s’accélère après le traumatisme de la canicule de l’été 2003, et mène à de nouvelles mesures : création de la CNSA, de la prestation de compensation du handicap (PCH) et des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). La nouvelle branche « Autonomie » de la sécurité sociale est créé en 2020. Elle « combine logique assurantielle et aide sociale, politique nationale universelle et décentralisation, rôle de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »
Pour Claude Martin, si l’autonomie demeure un concept ambigu et qui peut être mobilisé dans des argumentaires opposés, il s’agit d’adopter « une conception de l’autonomie centrée sur l’effort fait pour garantir aux personnes concernées la possibilité de faire valoir leurs propres choix » – logique adoptée en France par la CNSA. L’autonomie est ainsi à prendre comme un concept fédérateur et un horizon, qui n’insiste pas tant sur ce que les individus devraient faire pour être autonomes que sur ce que les sociétés leur offrent comme environnement pour accéder à la pleine citoyenneté.
La politique de l’autonomie existe-t-elle ? – Virginie Hoareau
Pour Virginie Hoareau, les objectifs des politiques de l’autonomie en France peuvent s’appliquer tant aux personnes âgées qu’aux personnes en situation de handicap, et « rejoignent les ambitions de la Convention internationale pour le droit des personnes handicapées (CIDPH) de 2006, qui ne pose pas de barrière d’âge aux principes et droits qu’elle soutient. » Il s’agit, quel que soit l’âge et le handicap, de donner des moyens au soutien de l’autonomie et de faire en sorte que ces moyens s’adaptent aux choix des personnes concernées, ne leur retire par leur pouvoir d’agir mais en contraire le renforcent.
Dans cette droite ligne, la CNSA a défini avec son conseil de parties prenantes un principe de « convergence sans confusion », qui « souligne l’importance de différencier, lorsque cela est nécessaire, les réponses entre une politique pour les personnes âgées et une politique pour les personnes en situation de handicap, tout en gardant le but commun du soutien de l’autonomie. »
Ce principe n’est cependant pas vu d’un bon œil par toutes les personnes concernées, et n’est pas toujours aisé à mettre en œuvre. Virginie Hoareau prend pour exemple les difficultés rencontrées lors des discussions autour de la disposition législative sur la création des Maisons départementales de l’autonomie (MDA), mesure à laquelle se sont opposées les associations du champ du handicap. Si quelques MDA ont bien été ouvertes, ces créations n’ont donc pas pu contribuer à une structuration à l’échelle nationale des politiques de l’autonomie à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Aussi, les avancées propres aux champ du handicap, en particulier du fait de la prestation de compensation du handicap, ne profite pas au champ de l’âge qui a du mal à s’extraire d’une vision « fonctionnelle » de la perte autonomie, et dont les outils peinent à intégrer la dimension de « projets » des personnes. »
Des avancées en matière de convergence des politiques de l’autonomie existent cependant.
Les Conseils de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), composés de différents collèges – personnes concernées, offreurs, institutions – font toujours davantage se rassembler et travailler personnes âgées et personnes en situation de handicap autour de sujets communs.
La mise en place d’un service public départemental de l’autonomie s’adresse tant aux personnes âgées qu’aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, et offre « un cadre de convergence sans pour autant remettre en cause les réponses spécifiques. »
La CNSA, devenue depuis 2021 une nouvelle branche de la sécurité sociale, est encore jeune et en cours de déploiement, et travaille sur le territoire en réseau avec de nombreux partenaires.
Virginie Hoareau conclut avec un bilan en demi-teinte, mais pour elle néanmoins prometteur : si « le passage à la branche n’a pas emporté la création d’un droit universel au soutien à l’autonomie […] la reconnaissance d’un risque place l’autonomie dans le champ de la solidarité nationale, avec pour principe de ne pas concerner seulement les personnes âgées ou seulement les personnes en situation de handicap. » Les divers projets de structuration en cours de développement sont ainsi les indices d’un progrès vers une approche transversale des politiques de l’autonomie.
Accéder aux ressources
Vous souhaitez télécharger la version complète compte-rendu du séminaire de recherche ou les consulter sur votre navigateur ? Rendez-vous sur la page du séminaire.
Vous souhaitez consulter nos autres ressources (fiches repères, infographies, répertoires, etc.) ? Rendez-vous dans l’onglet « Bibliothèque » de notre menu, et explorez-la en naviguant avec les filtres.
A propos de Claude Martin et Virginie Hoareau
Claude Martin est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a été enseignant-chercheur à l’université de Caen puis à l’Ecole nationale de santé publique, avant d’intégrer le CNRS en 1996 et de mener ses travaux au sein de l’UMR Arènes (Université de Rennes). Il a contribué à de nombreuses recherches à l’échelle nationale (ANR, MIRE-DREES, CNAF, IReSP, etc.) et européenne. Il a également été professeur affilié à l’EHESP et professeur invité à l’Institut national de la recherche scientifique de Montréal. Ses domaines de recherche concernent l’État social, la comparaison des systèmes de protection sociale, et plus précisément les politiques publiques en direction de la famille, de l’enfance, mais aussi depuis une trentaine d’années en direction des personnes âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap. Ses recherches ont contribué à plusieurs travaux préfigurateurs du champ de l’autonomie. En septembre 2020, il est nommé directeur du PPR Autonomie ; il assure cette fonction jusqu’en septembre 2023. Depuis, il est président du Conseil scientifique du programme.
Virginie Hoareau est responsable au pôle appui à la coordination des acteurs de Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Formée en gestion des établissements de santé à l’EHESP, elle a commencé sa carrière dans un établissement de santé spécialisé en santé mentale, expérience qui l’a formée aux enjeux de l’autonomie des personnes fragilisées. Elle a ensuite intégré une fédération nationale de défense des intérêts et des valeurs des hôpitaux publics et des structures médico-sociales relevant de ces établissements de santé. A cette occasion, elle a travaillé avec des représentants de l’État et de la CNSA, et a pu observer les fonctionnements institutionnels. Elle a par la suite exercé en cabinet ministériel auprès de Michèle Delaunay (ministre en charge des personnes âgées et de l’autonomie, 2012-2014), puis a travaillé à la conception et l’appui à la mise en œuvre de la politique de l’autonomie au ministère.
Actualités sur le même thème
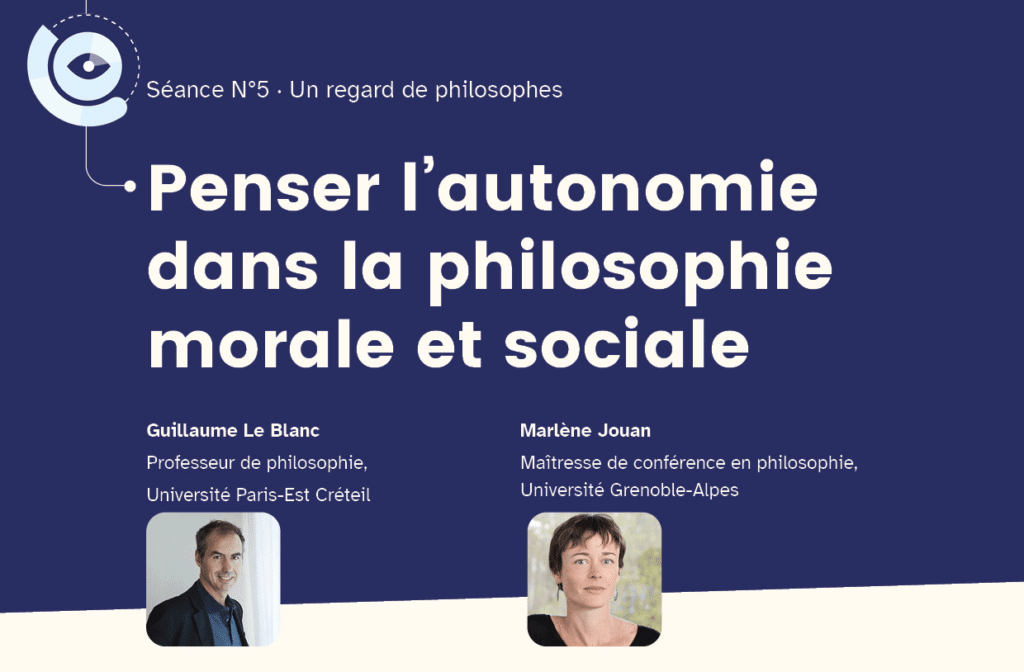
Penser l’autonomie dans la philosophie morale et sociale
L’autonomie est une notion ambiguë faisant l’objet de vifs débats philosophiques, allant jusqu’à une remise en question de la pertinence même de
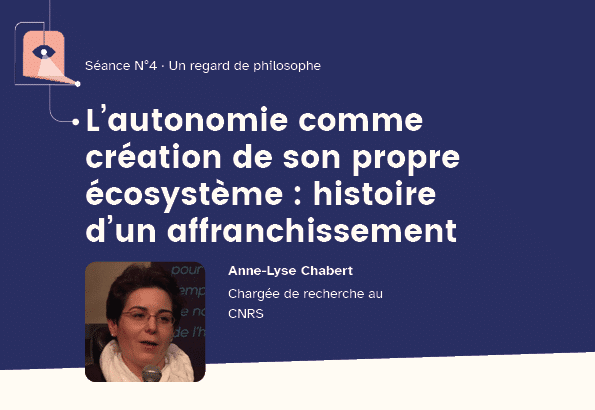
L’autonomie comme création de son propre écosystème : histoire d’un affranchissement
L’autonomie nous concerne toutes et tous : nous l’acquérons lorsque nous nous confrontons aux situations changeantes qui exigent que nous nous adaptions
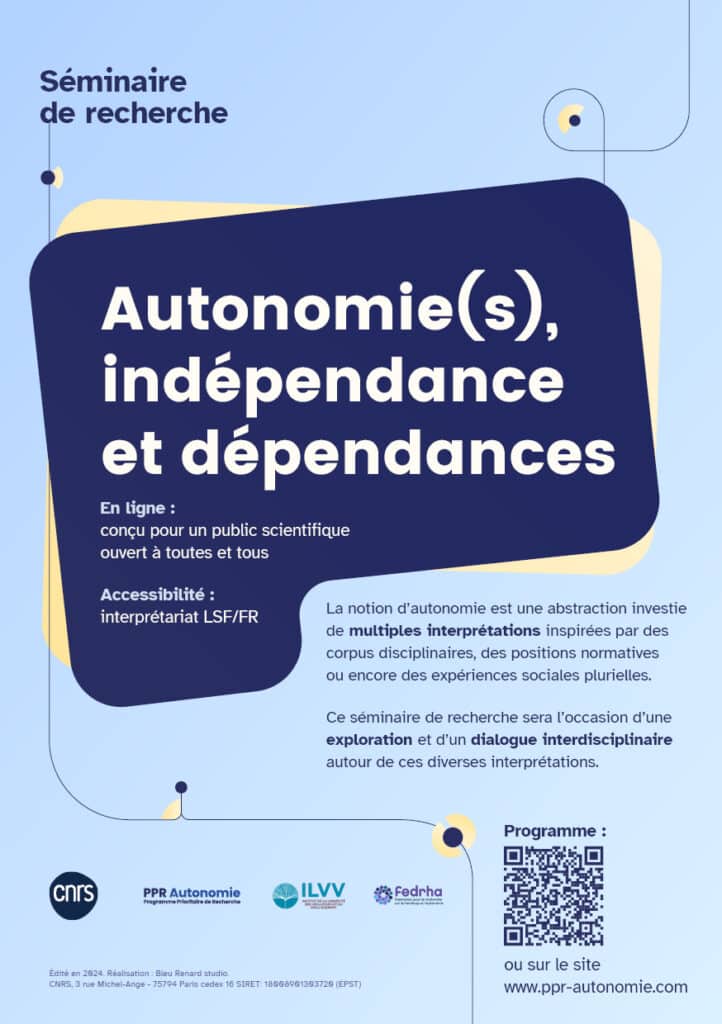
Autonomie(s), indépendance et dépendances
Séminaire de recherche interdisciplinaire.
