Comment le travail social a-t-il évolué, dans le contexte du développement des politiques publiques de l’autonomie ? Cyprien Avenel propose un parcours de la trajectoire de ce secteur très hétérogène, de ses origines à ses récentes mutations. Il revient sur les nouvelles conceptions de l’accompagnement, désormais structuré autour du mot d’ordre de « l’inclusion », et montre leur impact sur les métiers du travail social. Un panorama complexe se dessine, entre grandes ambitions politiques, déstructuration du cadre de travail et mise en œuvre empêchée.

Le travail social, entre unité et hétérogénéité
Le travail social est souvent défini de manière très générique. Il a pour but de favoriser l’accès des personnes aux droits fondamentaux, à la citoyenneté et à l’autonomie, lorsque leur environnement les en empêche.
Il comprend une grande diversité de professions et de missions, exercées dans des institutions très diverses. Ce secteur a été pris en charge et professionnalisé par l’État à partir du début du XXe siècle. Il a alors été structuré en trois grands champs : le service social, l’éducation et l’animation. Ses métiers se sont multipliés, surtout à partir des années 1980, parallèlement à la complexification des problématiques sociales.
La relation d’aide est au centre du travail social : il se dédie à l’accompagnement des personnes vers l’émancipation, grâce à l’éducation. Le travailleur social sert de médiateur entre les besoins individuels et les réponses institutionnelles existantes.
Promotion de l’autonomie ou injonction sociale ?
Les politiques sociales ont évolué vers une conception des personnes comme devant être les sujets des interventions qui les concernent. Aussi, l’accompagnement prodigué par les travailleurs sociaux ne peut plus être construit comme une démarche éducative.
« Cela situe l’autonomie entre désir personnel et nouvelle
injonction sociale relayée par les institutions. C’est pourquoi le travail social est parfois présenté non pas comme un travail sur autrui, mais avec autrui, où la « relation d’aide » se noue en « aide à la relation ». »
Le travail social est tantôt désigné comme un instrument de pouvoir des classes dominantes permettant de discipliner les classes dominées, tantôt comme impuissant face aux causes des problèmes qu’il cherche à traiter. Concentré sur la relation aux individus et sur leurs capacités à s’émanciper, il peut se transformer en injonction faite aux personnes de se prendre en main. Néanmoins, le manque de politiques menées à des échelles collectives empêche le travail social d’avoir un réel pouvoir transformateur.
Approche inclusive : les mutation des politiques sociales
« Ce sont les politiques en faveur du soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui portent l’ambition inclusive. »
La logique de l’inclusion repose sur la volonté d’inscrire prioritairement les personnes dans le droit commun et dans le milieu ordinaire. Les établissements spécialisés sont fortement critiqués, jusqu’à être désignés comme des lieux de ségrégation.
Il n’est plus question de prise en charge totale de la personne : toutes et tous doivent pouvoir évoluer dans la société, ce qui nécessite de construire des parcours d’accompagnement, de soin et de prendre soin adaptés aux besoins et aux aspirations de chacun. L’autonomie est pensée comme un processus relationnel et collectif, rendu possible par les environnements de vie. Le travail social doit, dans ce nouveau contexte, collaborer activement avec l’ensemble des acteurs du droit commun.
L’inclusion débouche sur l’émergence de nouveaux métiers du travail social, afin de mettre en œuvre cette logique de parcours adaptés et co-construits avec leurs bénéficiaires.
Une dégradation des conditions de travail
« La notion d’« autonomie empêchée » émerge pour qualifier ce phénomène d’écart entre, d’une part, l’action prescrite par les institutions et, d’autre part, la réalité de l’exercice professionnel. »
De nouveaux modes de gestion, centrés sur l’évaluation par la quantification, réduisent le temps de travail dédié à la relation. De plus, ils ne permettent pas de saisir l’efficacité réelle du travail social, qui passe par l’écoute, la disponibilité, le prendre soin : des activités qui nécessitent du temps pour être qualitatives et remplir leur fonction.
Le travail social s’effectue dans des conditions d’exercice dégradées : faibles salaires, journées morcelées, temps de trajet chronophage et non-indemnisés, etc. Les travailleurs témoignent aussi de leur mal-être face aux obstacles qui les empêchent de faire leur travail et de lui donner du sens.
Observer les conséquences de la transition inclusive
Le secteur du travail social est encore trop peu étudié. Au-delà des témoignages déjà apportés par les travailleurs, il est nécessaire de recourir à une sociologie du travail pour comprendre les évolutions relatives à la transition inclusive. On observe en effet notamment un essor des travailleurs sociaux exerçant à leur compte.
Ces métiers, jusqu’alors centrés sur la relation individuelle, sont amenés à muter vers des actions collectives, touchant à l’environnement de vie des personnes.
Accéder aux ressources
Vous souhaitez télécharger la version complète compte-rendu du séminaire de recherche ou les consulter sur votre navigateur ? Rendez-vous sur la page du séminaire.
Vous souhaitez consulter nos autres ressources (fiches repères, infographies, répertoires, etc.) ? Rendez-vous dans l’onglet « Bibliothèque » de notre menu, et explorez-la en naviguant avec les filtres.
A propos de Cyprien Avenel
Cyprien Avenel est docteur en sociologie, professeur associé à l’université Paris Saclay. Dans le cadre de son travail, il étudie l’action publique, plus particulièrement l’action sociale, le travail social et le médico-social. Il travaille en tant que conseiller expert du travail social et des politiques sociales à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Il a tenu a préciser que son intervention lors de cette séance du séminaire « Autonomie(s), indépendance et dépendance » est réalisée dans le cadre de son activité de chercheur en sociologie ; ses propos n’engagent que lui.
Actualités sur le même thème
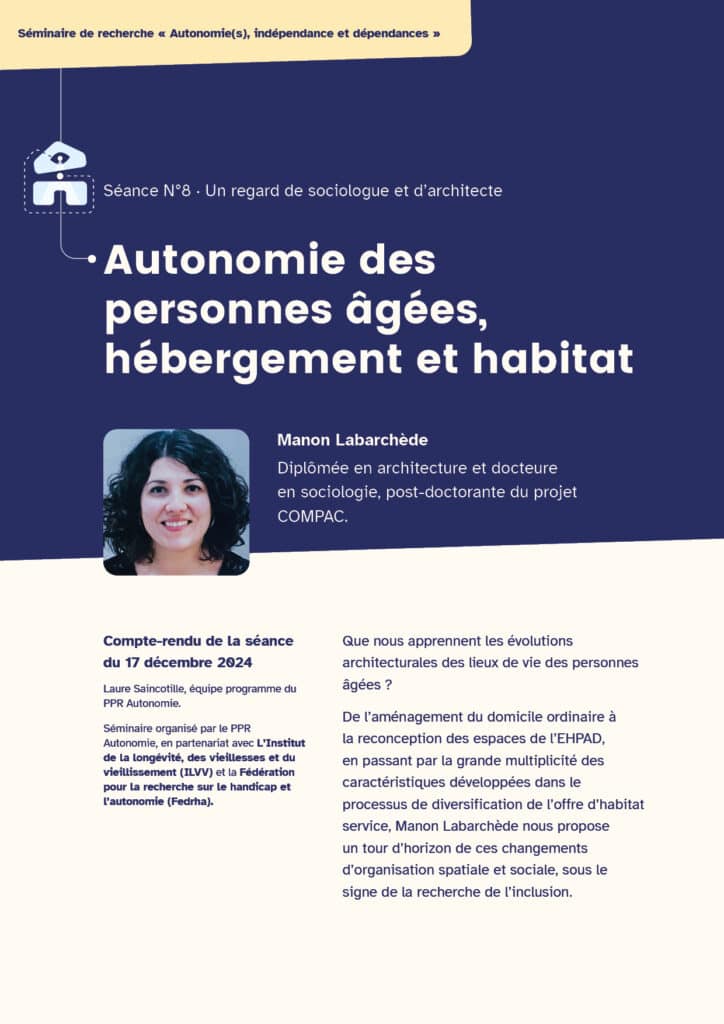
Autonomie des personnes âgées, hébergement et habitat
Que nous apprennent les évolutions architecturales des lieux de vie des personnes âgées ?
De l’aménagement du domicile ordinaire à la reconception des espaces de l’EHPAD, en passant par la grande multiplicité des
caractéristiques développées dans le
processus de diversification de l’offre d’habitat service, Manon Labarchède nous propose un tour d’horizon de ces changements d’organisation spatiale et sociale, sous le signe de la recherche de l’inclusion.
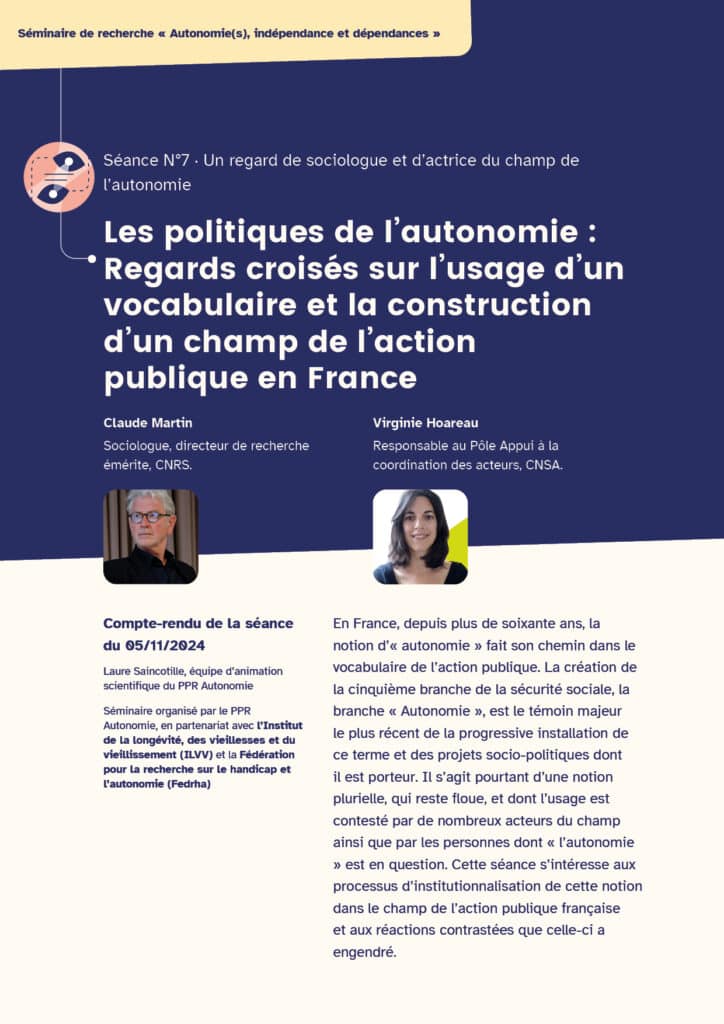
Les politiques de l’autonomie : regards croisés sur l’usage d’un vocabulaire et la construction d’un champ de l’action publique en France
En France, depuis plus de soixante ans, la notion d’« autonomie » fait son chemin dans le vocabulaire de l’action publique. La création de la cinquième branche de la sécurité sociale, la branche « Autonomie », est le témoin majeur le plus récent de la progressive installation de ce terme et des projets socio-politiques dont il est porteur. Il s’agit pourtant d’une notion plurielle, qui reste floue, et dont l’usage est contesté par de nombreux acteurs du champ ainsi que par les personnes dont « l’autonomie » est en question.
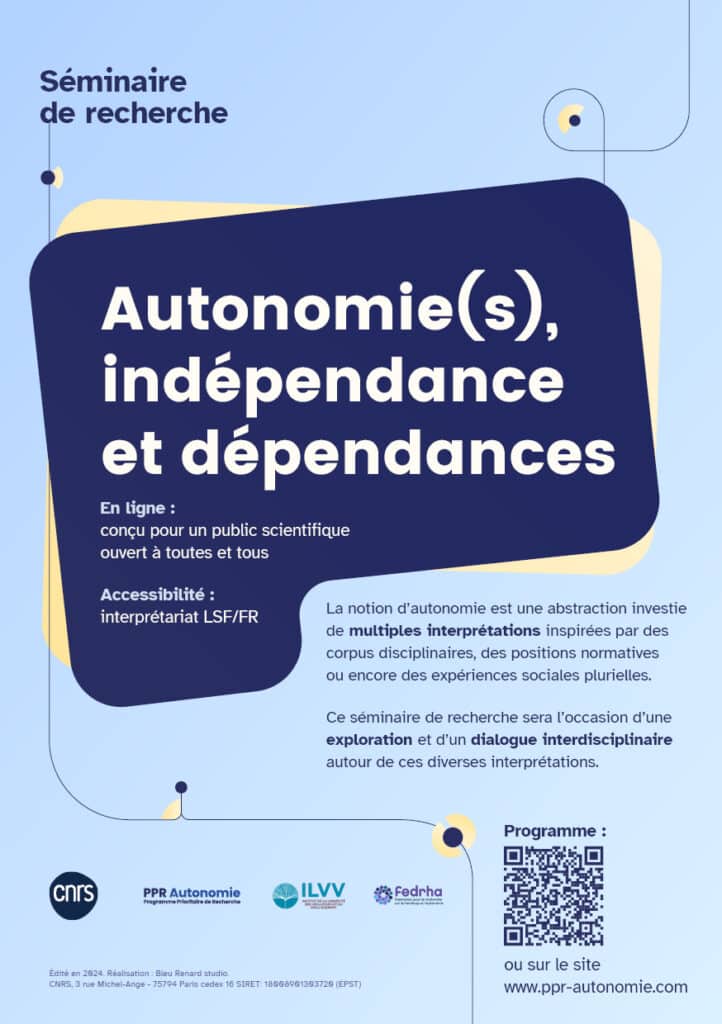
Autonomie(s), indépendance et dépendances
Séminaire de recherche interdisciplinaire.
