Les décideurs publics sont confrontés, au quotidien, à des dilemmes éthiques. Dans un contexte où les besoins sont nombreux et divers, et les ressources financières limitées, comment organiser leur juste répartition ? L’économiste Clémence Thébaut propose un tour d’horizon des applications des théories de la justice à l’économie, et des outils qui peuvent en être tirés pour concevoir les politiques publiques de l’autonomie.

Clémence Thébaut s’interroge sur les outils d’évaluation économique propres à la santé : peuvent-ils servir également pour les politiques de l’autonomie, malgré ce qui différencie les deux secteurs, surtout dans le contexte français ?
Ces outils font souvent appel aux théories de la justice pour permettre d’arbitrer des choix relatifs au financement. Cela rend encore davantage pertinent de chercher à reprendre ces outils dans le champ de l’autonomie, car la notion d’autonomie est au cœur des théories de la justice les plus récentes, qui visent à dépasser les limites du cadre utilitariste classique.
Concepts et outils d’évaluation économique en santé
En France, les dépenses relatives à la santé sont très socialisées, et les décideurs publics doivent savoir comment répartir ces dépenses. C’est pourquoi la question de la justice des politiques qu’ils mènent fait partie des problématiques à propos desquelles ils ont besoin d’appuis.
La discipline de l’évaluation économique en santé s’est développée pour répondre à ce besoin. Comment les meilleurs soins, aux moindres coûts ? Comment choisir les soins à prendre en charge et ce qui resteront à charge des patients ? C’est l’analyse coût-efficacité qui est privilégiée, le critère permettant de de déterminer ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas étant variable – le nombre d’années de vie gagnées ? la qualité de vie de ces années ?
La recherche d’un critère d’efficacité générique (et non pas spécifique à une pathologie en particulier) est ce qui intéresse le plus les économistes, car ils cherchent à fournir des outils de comparaison qui puissent être utilisés dans l’ensemble des domaines de la santé.
Construire une analogie entre domaine de la santé et champ de l’autonomie
Ce type d’outils est déjà utilisé dans les secteurs des transports et de l’environnement. Il pourrait également l’être dans celui de l’autonomie. Quel serait le meilleur outil pour ce secteur, afin d’être en mesure de déterminer les interventions que nos sociétés ont la responsabilité morale de fournir à l’ensemble de leurs membres, et la meilleure façon de les attribuer ?
Il s’agit, bien sûr, d’être efficace tout en s’adaptant au mieux à la diversité des besoins de chacun en matière d’autonomie.
« Il s’agirait donc de savoir comment mesurer cette efficacité, et selon quels critères ; de définir comment articuler les notions de besoin, d’efficacité et de coût dans le contexte de la perte d’autonomie. »
Les théories de la justice
Comment définir l‘objectif des politiques publiques de santé ou d’autonomie ? Est-ce, par exemple, le bien-être, l’espérance de vie, ou encore la réduction des inégalités ? Pour répondre à cette question, qui est fondamentale pour choisir quelles politiques développer, il est nécessaire de recourir aux théories de la justice.
La théorie de la justice utilitariste
Le calcul économique traditionnel repose sur la théorie de la justice utilitariste. Elle considère qu’il est juste de chercher à maximiser la quantité totale de bien-être à l’échelle de l’ensemble de la population. Chacun est juge de ce qui constitue, pour lui, le bien-être. L’autonomie est l’une des composantes possibles du bien-être.
Il est cependant difficile d’évaluer le bien-être : les personnes ont tendance à s’adapter aux situations qu’elles vivent, même les plus difficiles. On risque alors de considérer que les inégalités sociales sont acceptables, puisque chacun est capable de témoigner d’un bon niveau de bien-être en dépit de conditions de vie parfois très dures.
Le contractualisme de John Rawls
John Rawls a critiqué l’utilitarisme et développé sa propre approche, fondée sur une théorie contractualiste. Selon lui, si des personnes formaient les principes d’organisation d’une société au sein de laquelle ils ne connaîtraient pas leur future place, elles ne choisiraient pas l’utilitarisme, puisque celui-ci ne permet pas de prendre en charge les inégalités sociales.
Le modèle de justice qu’il propose repose sur quatre principes, dont le premier est le fondement des trois autres :
- respect des liberté fondamentales ;
- accessibilité universelle à l’ensemble des positions sociales ;
- garantie des bases sociales du respect de soi ;
- répartition équitable des biens premiers.
Ainsi, si l’on suit Rawls pour évaluer les politiques publiques, il semble que celles dédiées à l’autonomie soient considérées comme prioritaires, puisqu’elles visent à ce que tous et toutes puissent mener à bien leur projet de vie.
Amartya Sen et les capabilités
Amartya Sen reprend les théories de Rawls tout en les critiquant. Pour lui, il n’y a pas de raison que nous donnions une priorité absolue à la protection des libertés individuelles – cela n’a pas de sens si, par ailleurs, nous mourrons de faim.
Pour Sen, répartir équitablement les ressources n’est pas suffisant : il faut aussi s’assurer que chacun soit en mesure de s’en saisir pour mener à bien son projet de vie. La notion de « biens premiers » est à remplacer par celle de « libertés concrètes », qu’il appelle « capabilités ». Les capabilités doivent être définies localement, en fonction des besoins concrets des personnes, de ce qui leur permettra d’agir dans le contexte social qui est le leur.
Quelles interventions rembourser, selon les différentes théories de la justice ?
- approche utilitariste : les interventions permettant de maximiser la quantité de bien-être collectif ;
- approche rawlsienne : en priorité les interventions permettant de garantir le respect des libertés fondamentales ;
- approche des capabilités : les interventions permettant de garantir la réalisation des fonctionnements essentiels dans les contextes donnés.
Le projet de recherche Equidec-2
« Le projet de recherche Equidec-2 […] propose de mobiliser la littérature sur les théories de la justice appliquée à l’évaluation des politiques publiques pour les personnes en situation de perte d’autonomie liée à l’âge. »
Le projet tient compte du cadre actuel des politique publiques de l’autonomie : la décentralisation et l’approche pluraliste. Différents modèles de justice sont mobilisés, pour répondre à la diversité des objectifs que se fixent les collectivités.
L’évaluation de l’équité géographique, dans ce contexte, peut amener à montrer l’existence d’inégalités de résultats entre les départements. Il ne faut pas nécessairement en conclure à un manque de justice. Cela peut être le fait d’un choix de la collectivité – par exemple, si l’on évalue l’accès à l’EHPAD dans un département ayant décidé de privilégier les politiques de maintient à domicile.
Accéder aux ressources
Vous souhaitez télécharger la version complète compte-rendu du séminaire de recherche ou les consulter sur votre navigateur ? Rendez-vous sur la page du séminaire.
Vous souhaitez consulter nos autres ressources (fiches repères, infographies, répertoires, etc.) ? Rendez-vous dans l’onglet « Bibliothèque » de notre menu, et explorez-la en naviguant avec les filtres.
A propos de Clémence Thébaut
Le parcours de Clémence Thébaut, commencé dans le domaine de l’économie de la santé, l’a progressivement menée à s’intéresser au champ de l’autonomie. Commençant par travailler sur l’adaptation des méthodes d’évaluation économique en santé à différents modèles de justice, elle a exercé pendant dix ans à la Haute autorité de santé (HAS). Elle y a été chargée de l’évaluation des stratégies de santé.
Dans un second temps, après avoir rejoint l’Université de Limoges, elle a été invitée à participer au groupe de recherche Equidec-2, piloté par Cécile Bourreau-Dubois et Agnès Gramain, qui porte sur l’évaluation de l’équité géographique dans l’accès aux prises en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge. Dans ce cadre, elle s’intéresse à l’évaluation de l’équité géographique de la prise en charge de la perte d’autonomie liée à l’âge.
À télécharger :
Actualités sur le même thème

Le travail social dans la transition inclusive des politiques de l’autonomie
Comment le travail social a-t-il évolué, dans le contexte du développement des politiques publiques de l’autonomie ? Cyprien Avenel propose un parcours de la trajectoire de ce secteur très hétérogène, de ses origines à ses récentes mutations.
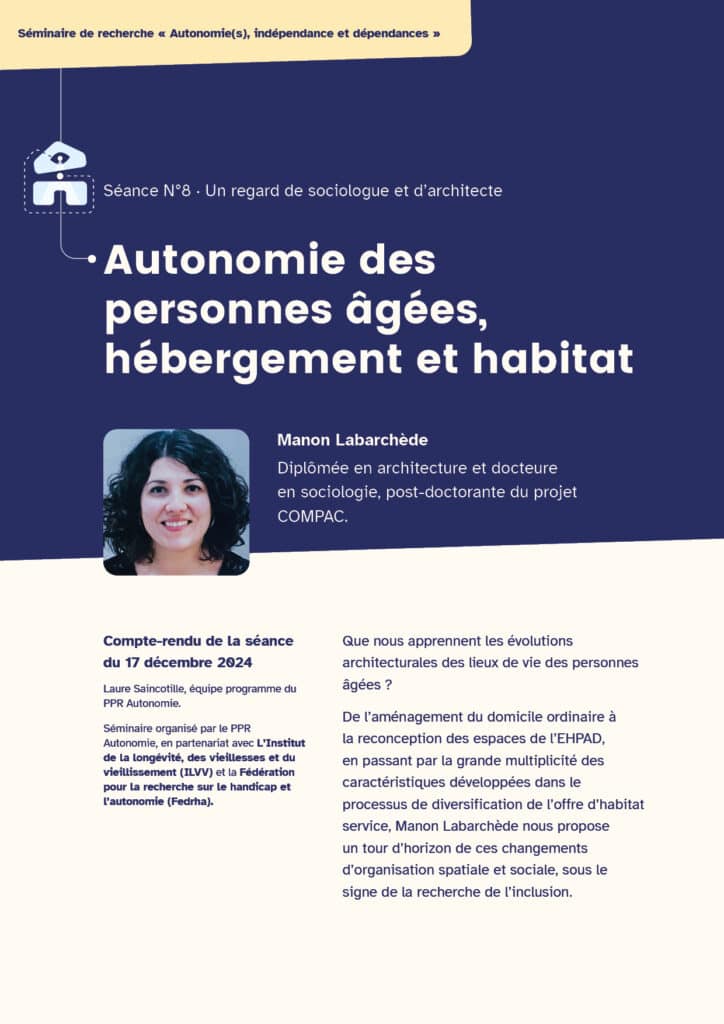
Autonomie des personnes âgées, hébergement et habitat
Que nous apprennent les évolutions architecturales des lieux de vie des personnes âgées ?
De l’aménagement du domicile ordinaire à la reconception des espaces de l’EHPAD, en passant par la grande multiplicité des
caractéristiques développées dans le
processus de diversification de l’offre d’habitat service, Manon Labarchède nous propose un tour d’horizon de ces changements d’organisation spatiale et sociale, sous le signe de la recherche de l’inclusion.
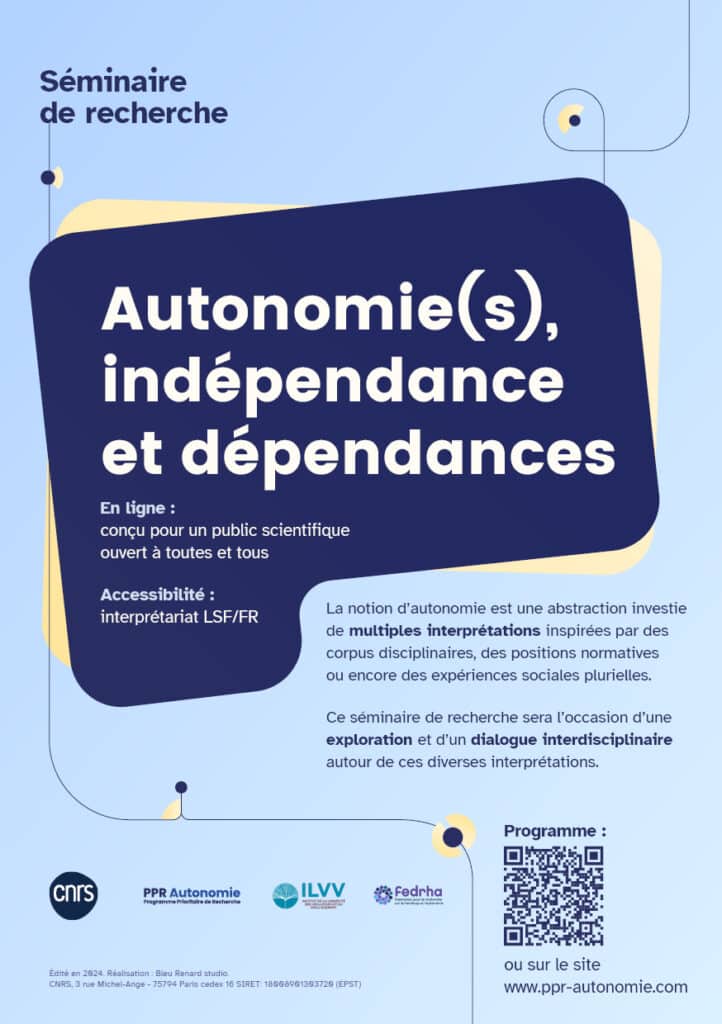
Autonomie(s), indépendance et dépendances
Séminaire de recherche interdisciplinaire.
