Que peut nous apprendre l’histoire des maisons de retraite et de l’assistance publique pour les personnes âgées sur la crise actuelle du secteur ? Quelles sont les pistes possibles pour sortir des pratiques maltraitantes et améliorer les conditions de vie des aînés ? Réponse avec Mathilde Rossigneux-Méheust autour de la présentation de son ouvrage Vieillesses irrégulières (La Découverte, 2022), et en discussion avec Laurence Delleur et Manon Aussillou Boureau.
Visionner la rediffusion
Présentation du livre de Mathilde Rossigneux-Méheust

Villers-Cotterêts : de la mendicité à la retraite
Château prestigieux marqué par l’histoire, Villers-Cotterêts est devenu au 19e siècle un dépôt de mendicité : on y enfermait les vagabonds trouvés sur la voie publique pour les réformer, avant de les renvoyer dans leur ville d’origine.
Établissements peu financés par l’État, ces dépôts sont devenus la honte de la IIIe République et ont été peu à peu transformés en hôpitaux psychiatriques ou en maisons de retraite. En effet, beaucoup des mendiants arrêtés étaient des personnes âgées. Le château est devenu une maison de retraite en 1889, mais est resté géré par la Préfecture de police.
Un établissement singulier
C’est également au 19e siècle qu’une cinquantaine de maisons de retraite ont été ouvertes à Paris. L’établissement de Villers-Cotterêts est à cet égard singulier et marqué par le contraste : il s’y déployait une forte pratique disciplinaire, mais également une volonté de se débarrasser d’attributs qui étaient, déjà à l’époque, jugés « peu humanisant ».
Beaucoup de résidents y travaillaient, ce qui faisait baisser considérablement son prix de journée. Certains droits y étaient reconnus. Cependant, il restait un hospice repoussoir : on ne voulait pas y « finir ».
Un important réservoir d’archives
Beaucoup de dossiers de résidents de Villers-Cotterêts au XXe siècle ont été conservés, fait assez rare qui a offert à Mathilde Rossigneux-Méheust de nombreuses sources d’étude. Les carnets de punition, plus particulièrement, ont attiré son attention. Ces cinquante carnets, tenus entre les années 1940 et 2005, évoquent ouvertement les pratiques correctionnelles d’un établissement pour personnes âgées et ouvrent la possibilité de mieux connaître cette population et son quotidien en institution.
Dans les archives de la maison de retraite, l’historienne trouve également un fichier contenant un peu plus de 300 fiches bristol dédiées chacune à un homme ou une femme ayant quitté l’établissement. Les fiches comptabilisent le nombre de rapports de punition dont ils et elles ont fait l’objet, décrivent leur comportement général et comprend une appréciation. On y parle de leur « méchanceté », de leur « insatisfaction », de leur « alcoolisme », des scandales qui les ont impliqués, et on les décrit comme étant « à ne pas reprendre ».
Rejetés de l’assistance obligatoire
Ces fiches présentent un paradoxe qui interroge : ces résidents étaient déclarés « indésirables » alors même qu’ils avaient été jugés, après d’importantes démarches de leur part, comme ayant droit à l’assistance publique.
Qui sont ces personnes qui ne correspondaient pas au profil du résident modèle, au point d’être désignées comme étant à exclure d’un lieu peu enviable, où personne ne souhaite finir sa vie ?
L’usage de mots pourtant tabous
La période durant laquelle ces carnets de punitions et ces fiches bristol ont été produits a été marquée par l’« humanisation » du traitement de la vieillesse. Pourtant, ce sont des termes alors tabous qui étaient utilisés pour qualifier les résidents que les établissements ne voulaient plus voir revenir : les « indésirables » risquaient l’« épuration ». Utilisés sous Vichy pour qualifier l’immigration irrégulière, ils ont été bannis du vocabulaire des migrations après la Libération, mais néanmoins employés dans les maisons de retraite – qu’elles aient une bonne ou une mauvaise réputation.
Qui vit à Villers-Cotterêts ?
Remplir les lits
La maison de retraite peinait à remplir ses lits, ce qui lui posait des problèmes financiers. Elle acceptait donc presque tous ceux et celles qui souhaitaient y entrer, et en en est venue à accueillir des personnes relativement jeunes, notamment en raison d’un handicap important, sans que leur âge fasse l’objet d’une discussion. Ces archives permettent également de dresser le portrait d’une génération qui, née à la fin du 19e siècle, a traversé les deux guerres mondiales, la crise des années 1930, et amenait avec elle à l’hospice ses traumatismes.
Le problème de l’alcool
Le fichier des « indésirables » révèle qu’une bonne partie d’entre eux étaient sujets à l’alcoolisme, ce qui était un objet de préoccupations importantes pour l’établissement : introduction d’alcool dans les dortoirs, hurlements, scandales et blessures sont relatés, et menaient à de nombreuses punitions parfois très brutales, pouvant aller jusqu’à nécessiter un passage par l’infirmerie. Les « buveurs » faisaient rarement l’objet de dénonciation de la part des autres résidents, qui craignaient probablement les altercations violentes dans lesquelles ils étaient impliqués.
Les malades issus de la psychiatrie
Villers-Cotterêts trouvait un arrangement administratif pour remplir ses lits en en dédiant 20% à des malades issus d’hôpitaux psychiatriques considérés comme étant stabilisés. Après trois mois de permission renouvelables, et si leur comportement s’avérait « compatible » avec l’établissement, ils pouvaient être définitivement admis, ou au contraire réintégrés à l’hôpital. Ces personnes étaient moins fichées que le reste de la population de l’hospice, mais elles faisaient davantage l’objet de plaintes de la part des autres résidents, qui ne souhaitaient pas vivre dans « un établissement de fous ».
Une population pauvre
Tous les résidents n’avaient pas un parcours de pauvreté au long cours, mais ils étaient tous pauvres lors de leur admission – ils et elles ont dû prouver leur absence de ressources économiques pour pouvoir entrer à Villers-Cotterêts. Ils étaient nombreux à être tombés dans la pauvreté à la suite de l’une des deux guerres mondiales.
De l’impact des fiches : le nomadisme des indésirables
Ce fichage était un système à l’échelle de l’ensemble des maisons de retraite, organisé afin de tenir à distance les quelques individus qui étaient considérés comme gênants pour le fonctionnement des institutions. Cependant, ces fiches n’empêchaient pas les personnes de revenir, que cela soit à Villers-Cotterêts ou dans d’autres hospices, et ce à de nombreuses reprises : l’assistance était une obligation légale. Ce phénomène a été désigné à l’époque comme du « nomadisme institutionnel ». Il était parfois orchestré par les établissements eux-mêmes, qui participaient à cette circulation en s’échangeant certains résidents.
Un très long mouvement vers « l’humanisation »
Dès les années 1880, la question s’est posée des moyens de réformer l’assistance publique afin qu’elle ne soit pas aussi nettement l’héritière de la prison. Uniformes, prix du travail, droits de sortie et de circulation : tout cela faisait l’objet de réflexions pour améliorer les conditions de vie de celles et ceux qui résident dans les hospices et les hôpitaux. Pourtant, certains établissements comme celui de Villers-Cotterêts ont peu changé et ont été de plus en plus en discordance avec la société française, surtout lorsque le niveau de vie s’est accru dans les années 1970.
La dénonciation du mauvais traitement de la vieillesse
Les années 1970 ont connu un important mouvement de dénonciation des conditions de vie des personnes âgées dans les établissements de l’assistance publique. Les reportages sur les grands dortoirs des hospices se sont multipliés, et divers ouvrages sur le sujet ont fait date, comme La vieillesse (Simone de Beauvoir, 1970), Les vieux vont mourir à Nanterre (Carmen Bernand, 1978), Vieillesse des pauvres (Nicole Lapierre, 1980), etc. Ces ouvrages, à la frontière entre le livres politique et de livre de sciences sociales, documentaient la vie d’hospice afin d’alerter l’opinion publique sur ce qu’il s’y passait.
Des conditions de soin qui mènent aux maltraitances
Les carnets de punition nous apprennent que les corrections se situaient toujours à la frontière entre le soin et la coercition. Le sevrage brutal des personnes alcooliques était pratiqué à défaut de moyens pour s’occuper autrement des résidents : à l’époque, les divertissements étaient très limités, et faute de finances le personnel encadrant était peu nombreux et rarement formé. Bien que cela n’excuse aucunement les maltraitances, le personnel tentait de traiter les résidents avec humanité, mais les conditions de l’hospice dégradaient fortement les relations de soin.
Les insatisfaits
Parmi les personnes fichées se trouvaient de nombreux « insatisfaits ». Catégorie qui n’était pas sujette aux punitions car ne présentant pas de comportements excessifs, elle désignait les résidents qui écrivaient beaucoup au directeur de l’hospice. Ces lettres ont été lues et abondamment annotées.
Table-ronde – Vieillir en institution, hier, aujourd’hui… demain ?
Histoire, enquête journalistique et sociologie mise en pratique : les invitées de l’émission, après avoir présenté leurs activités respectives, ont échangé sur les implications contemporaines des dynamiques explorées dans l’ouvrage de Mathilde Rossigneux-Méheust.
Elles ont évoqué la crise actuelle du système d’assistance, mais également des pistes de changement, pour sortir des pratiques de maltraitance engendrées par les techniques gestionnaires visant non pas le bien-être, mais les économies budgétaires et les opérations financières.
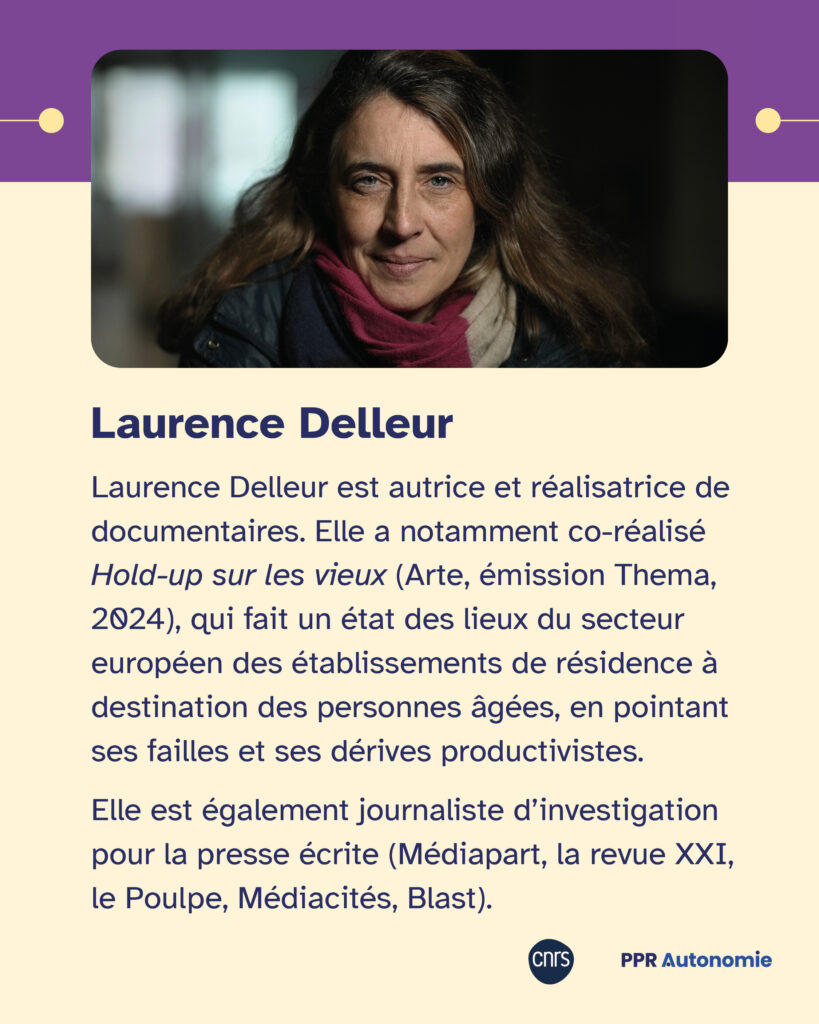
Laurence Delleur : une enquête dans les EHPAD européens
Suite au scandale d’Orpea et de la sortie du livre de Victor Castanet Les Fossoyeurs (Fayard, 2022), Laurence Delleur, accompagnée de sa société de production CAPA et en binôme avec la réalisatrice et monteuse Nathalie Amsellem, a souhaité savoir si la recherche de rentabilité était endémique au secteur des EHPAD, et si en enquêtant sur la question dans plusieurs pays européens il était possible d’en tirer une analyse systémique.
Le documentaire Hold-up sur les vieux, sorti en 2024, nous emmène dans cette investigation transnationale.
Le cas de l’Espagne
En Espagne, Laurence Delleur découvre la toute-puissance de l’entreprise DomusVi. Numéro 3 du secteur en Europe, il s’agit d’une entreprise française comme Orpea et Korian (désormais Clariane). Présente dans toutes les régions autonomes d’Espagne, elle est la seule à couvrir ainsi le territoire. Ce pouvoir, elle le tire de la proximité de sa dirigeante avec le président du Parti populaire d’Espagne, ce qui permet à l’entreprise d’être peu contrôlée et peu inspectée. Aussi, lorsqu’un résident est maltraité, s’il survit aux mauvais traitements, il doit souvent retourner dans un autre établissement DomusVi.
La financiarisation
Des groupes extrêmement puissants se forment dans le secteur des EHPAD, particulièrement au Royaume-Uni. Ils achètent des maisons de retraite dans des opérations financières très rentables. Pour ces acquéreurs, la pérennité des établissements, qui permet aux salariés d’exercer leur profession et aux résidents de vivre dans un environnement stable, n’est pas un but. C’est l’ensemble du secteur qui en sort malmené, et les personnes âgées doivent souvent déménager – ce qui est aussi très difficile pour les familles, qui peinent à trouver à leurs parents un nouveau logement à proximité et de qualité.
Aide à domicile : le cas de l’Allemagne
En Allemagne, pays qui investit plutôt le maintien des personnes âgées à leur domicile, c’est davantage de secteur de l’aide à domicile qui est impacté par les politiques financières des grands groupes. Les aides à domicile sont exploitées, au mépris du droit du travail allemand pourtant très strict. Les familles se voient promettre des travailleurs qualifiés et toujours disponibles, tandis que les travailleurs pensent pouvoir s’occuper de personnes âgées en pleine santé.
La réalité du terrain est toute autre.
La responsabilité politique
Pour Laurence Delleur, il est important d’évoquer la façon dont le secteur privé lucratif en est venu à prendre en charge les plus vulnérables : dans chaque pays, cette prise en charge était initialement portée par le secteur public gratuit, et son passage au secteur privé est le fait d’une décision politique.
L’objectif de ce désinvestissement public volontaire est de faire en sorte que la prise en charge des personnes vulnérables coûte moins cher.
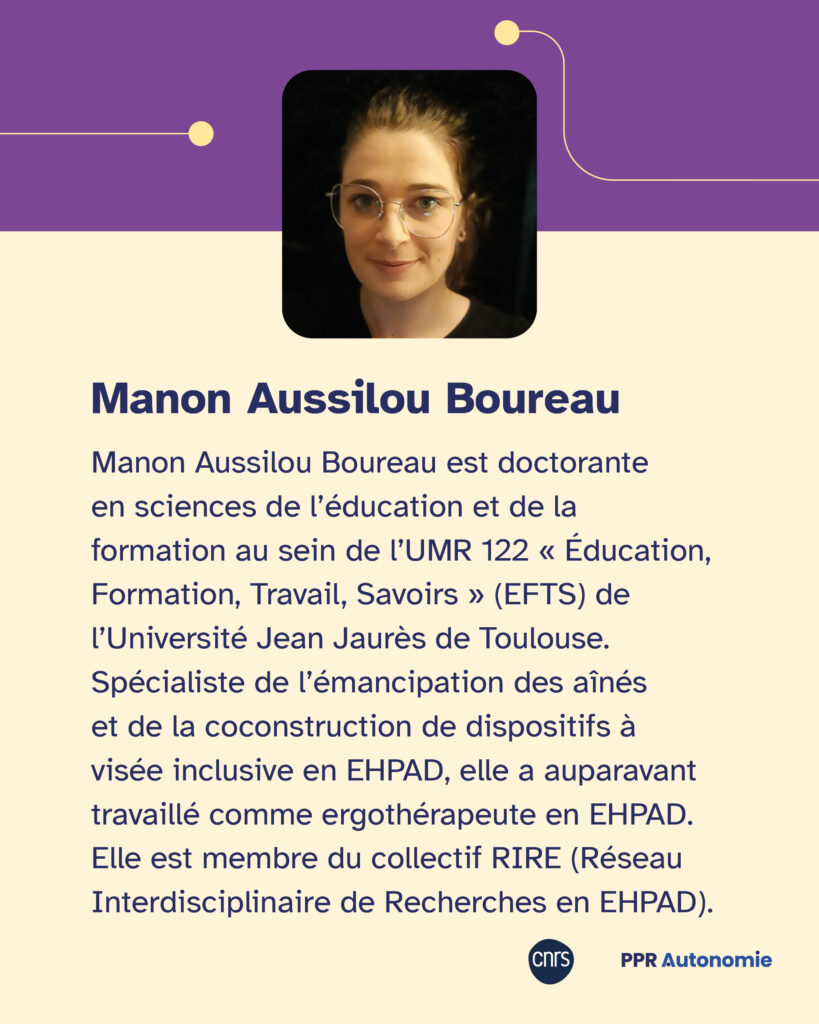
Manon Aussillou-Boureau : une recherche-intervention
La thèse de Manon Aussillou-Boureau s’effectue dans le cadre particulier de la recherche-intervention : comme toute recherche, elle vise à produire des connaissances, mais aussi à accompagner des processus de changement au sein des EHPAD. Les dispositifs de recherche sont coconstruits avec les établissements, et débouchent sur des expérimentations en leur sein, qui mobilisent les professionnels, les résidents et leurs proches.
Réfléchir et faire changer ensemble
Des groupes de travail sont constitués : il s’agit de partir de situations concrètes de la vie quotidienne dans les établissements, que les différentes parties-prenantes souhaiteraient améliorer ou pérenniser. Ces situations sont éclairées par le vécu de chacun des participants, et préludent à des montées en généralité théoriques permettant de structurer le regard critique et d’imaginer des pistes d’actions pour faire évoluer les situations à travers des expérimentations pratiques.
Le processus d’émancipation
L’objectif des recherches est de documenter le processus d’émancipation des aînés dans les EHPAD.
Lorsqu’une personne âgée s’installe dans un établissement, sa place au sein de cette micro-société régie par ses normes propres lui est très souvent attribuée sans qu’elle l’ait choisie. Avec le temps, au cours d’un processus d’émancipation, elle trouvera probablement une place qu’elle aura choisie. Ce processus dépend de l’environnement au sein duquel il se déroule – matériel, humain, social, symbolique.
Maltraitances en EHPAD : une situation généralisée
Laurence Delleur précise que les maltraitances des personnes âgées ne sont pas le propre des EHPAD privés. Les EHPAD publics sont également en difficulté et manquent de personnel : gérés par les Centres communaux d’action sociale (CCAS), 80% d’entre eux sont aujourd’hui en déficit.
Cependant, à la différence des établissements privés, l’argent qui y est investi ne sert pas à rétribuer un actionnaire ou un fond d’investissement, mais sert directement la personne âgée.
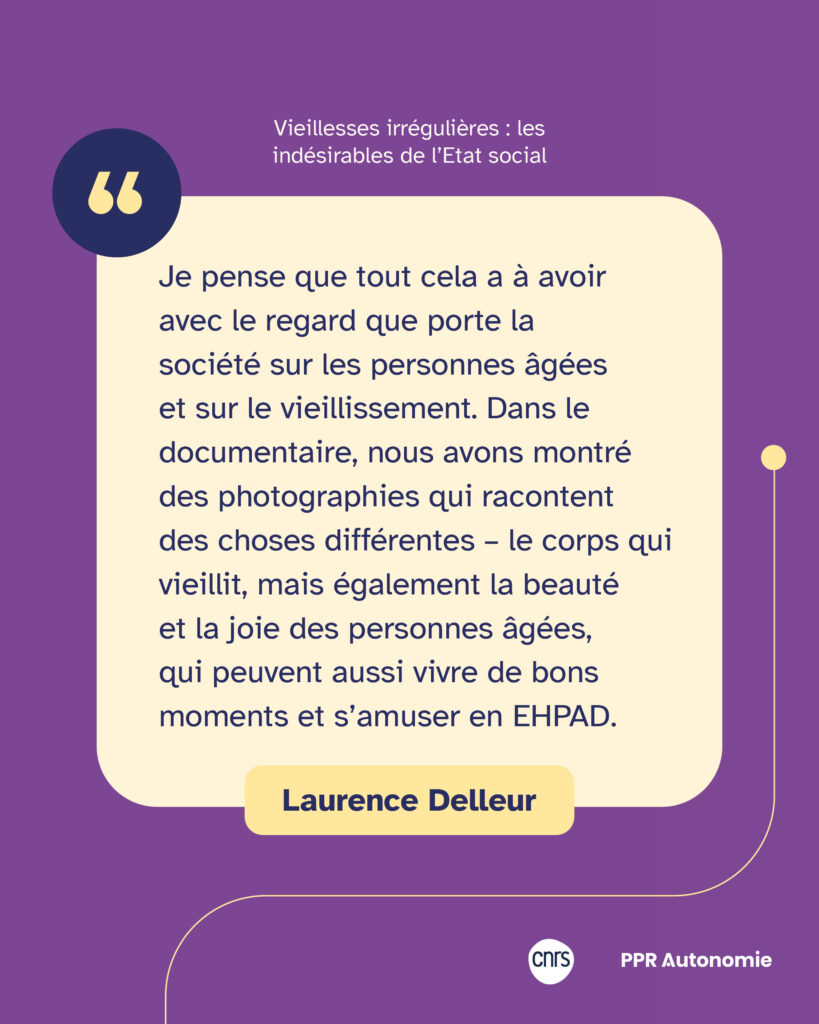
Privation de liberté et isolement
Laurence Delleur note qu’en 2009, Jean-Marie Delarue, premier contrôleur des lieux de privation de liberté, envisageait les EHPAD comme faisant partie de ses objets de préoccupation, au même titre que les prisons et les hôpitaux psychiatriques. Les personnes âgées y sont en effet considérées et traitées de manière similaire. De plus, les EHPAD sont souvent tenus à l’écart des villes, ou entourés de hauts murs, et les proches ont des difficultés à y visiter leurs parents.
Ailleurs qu’en France ou en Espagne, les établissements sont au contraire des lieux ouverts sur le monde extérieur et la société – notamment au Danemark.
De la personne aux « personnes âgées »
Manon Aussillou Boureau note que les personnes âgées sont invisibilisées au sein de la société, et que l’on a tendance à les considérer comme un groupe social homogène – comme si à partir d’un certain âge, nous réduisions les personnes à être des « personnes âgées ». Pourtant, nous arrivons en EHPAD avec derrière nous une vie entière et de nombreuses expériences qui nous ont construits : c’est avec ce bagage que nous rencontrons les normes de l’établissement, la place qui nous y est faite, et que nous parvenons – ou non – à nous y adapter.
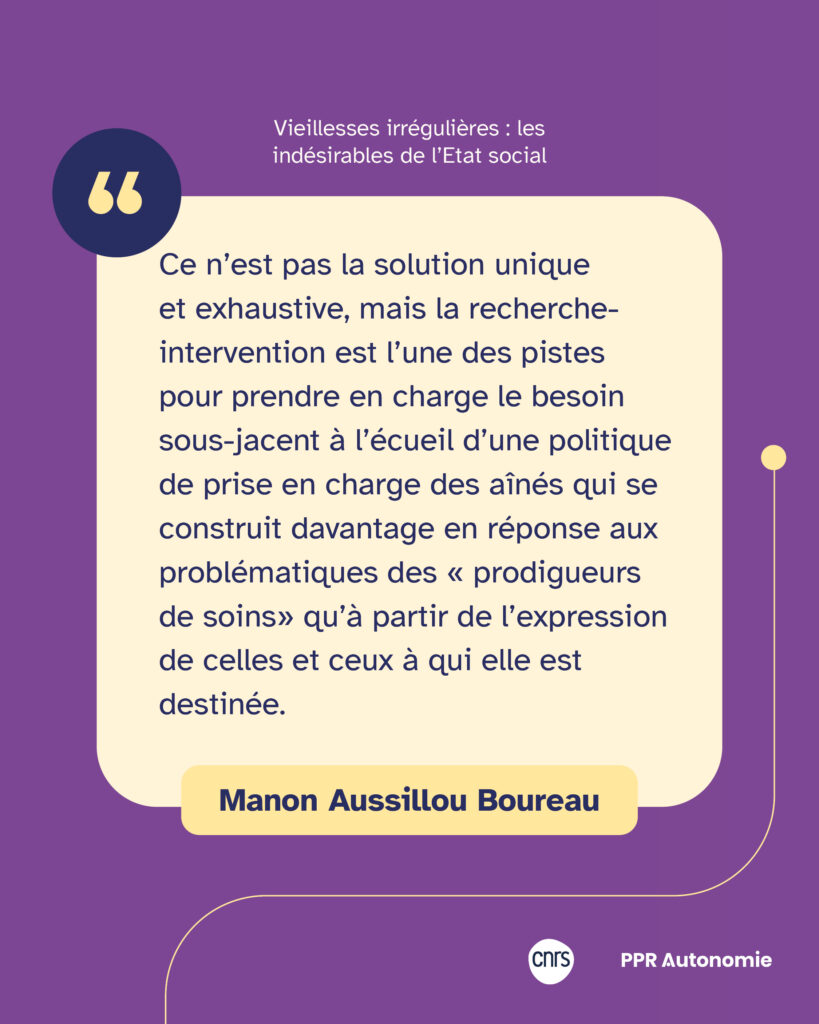
L’apport de la recherche-intervention
La recherche-intervention a pour point de départ une commande de recherche participative, celle-ci évoluant en fonction des personnes impliquées dans les travaux et qui en sont les bénéficiaires. Manon Aussillou-Boureau est attachée à promouvoir une dynamique de recherche permettant l’émergence et la prise en considération des « savoirs invisibles » des personnes concernées : s’efforcer d’accéder à ce qui, faute d’y prêter attention, est manqué par les scientifiques, et ne peut alors pas être pris en compte dans les réflexions autour d’une situation problématique.
Ralentir le temps de la réflexion
Le dialogue et la coconstruction qui font interagir les scientifiques, les professionnels, les personnes âgées et leurs proches appelle à un ralentissement : réfléchir plus longuement pour avoir le temps de faire connaissance, découvrir ces savoirs qui ne se dévoilent pas au premier abord, et accompagner le changement de sorte à ce qu’il soit non pas une marche forcée, mais bel et bien un processus d’émancipation des individus.
Reprendre l’histoire des luttes
Mathilde Rossigneux-Méheust revient sur l’histoire des luttes. Le mouvement de dénonciation des hospices de l’assistance publique qui a pris la parole dans les années 1970 a selon elle eu pour effet de venir masquer l’histoire politique attachée à ces institutions. Celles-ci étaient en effet perçues, au XIXe siècle, comme étant très modernes, tant dans leurs moyens matériels d’accueil que dans les formes de solidarité très fortes qu’elles permettaient de développer pour les personnes âgées.
Des mobilisations à l’hospice
La grande diversité des profils des résidents des maisons de retraite (âge, statut médical, handicap), quoi qu’ils soient la plupart du temps issus des classes populaires, a permis l’émergence de mobilisations. Les résidents étaient les lobbyistes de leurs propres causes – le « droit à la tombe », par exemple, contre l’utilisation des corps dans les amphithéâtres de médecine.
Cela vient déjouer l’idée que ces établissements étaient nécessairement pire que tout autre mesure d’assistance, qu’aucune forme de liberté ne pouvait s’y déployer. Ces mouvements, construits et portés par les résidents, étaient ensuite politisés par la gauche radicale de l’époque – des dynamiques qui ne sont plus portées actuellement.
Le rôle des sciences sociales
Pour Mathilde Rossigneux-Méheust, il est important de ne pas tomber dans l’oubli institutionnel. Les propositions d’aujourd’hui de créer un cadre de vie plus humain pour les personnes âgées – habitat intergénérationnel, inclusion des résidences spécialisées au sein de la cité – ne datent pas d’hier. S’il est faux d’affirmer que « ces solutions ont déjà été appliquées par le
passé », mettre ensemble les sciences sociales et les différentes parties-prenantes des situations de déshumanisation permettrait de les rendre davantage visibles et de fluidifier leur résolution.
Les mobilisations actuelles
En menant ses enquêtes, Laurence Delleur a rencontré de nombreuses personnes âgées – parfois de plus de 90 ans -, qui avaient beaucoup à dire sur leur condition. Elle a également noté qu’il existe au sein d’EHPAD des mobilisations qui rassemblent professionnels et résidents autour de la problématique du manque de moyens. Enfin, elle relève qu’il existe en France quelques associations tentant de représenter les personnes âgées.
Francis Carrier, par exemple, a contribué à la création du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Quoi que ces mouvements ne soient pas aussi massifs que ceux du Danemark, ils pourraient en venir à constituer une forme de lobbying des personnes âgées.
Les conditions de la prise de parole
Manon Aussillou Boureau note que dans les groupes de travail avec lesquels elle travaille, les personnes ont besoin de temps pour arriver à participer à l’échange qui est en cours. Il faut ouvrir des espaces pour que cette parole puisse émerger – en construire les conditions de possibilité, mais aussi de réception et d’écoute. En outre, certaines personnes résidant en EHPAD vivent avec des problèmes médicaux, parfois des troubles cognitifs : recueillir leurs points de vue et leurs souhaits est nécessaire et appelle l’élaboration de dispositifs permettant d’aller au-delà des difficultés médicales.
Le Cornet acoustique : la reco culture du PPR

Dans son roman Le Cornet acoustique, écrit au milieu du XXe siècle, Léonora Carrington nous propose de suivre l’héroïne et narratrice Marion Leatherby, 99 ans, adepte du choux-fleur et du tricot en poils de chat. Lorsque sa meilleure amie lui offre un cornet acoustique pour palier à sa surdité grandissante, Marion découvre que sa famille a pris la décision de la placer dans un établissement pour personnes âgées.
Ce court roman aborde avec finesse le vieillissement et les questions de genre. Notez cependant qu’y apparaît un terme raciste, qui était à l’époque encore utilisé et qui contraste avec l’actualité de l’ensemble.
S’éloignant des représentations convenues, Leonora Carrington nous propose le récit d’une émancipation où la vieillesse des femmes est une aventure joyeuse à la rencontre de la liberté.
Découvrez l’émission et sa programmation
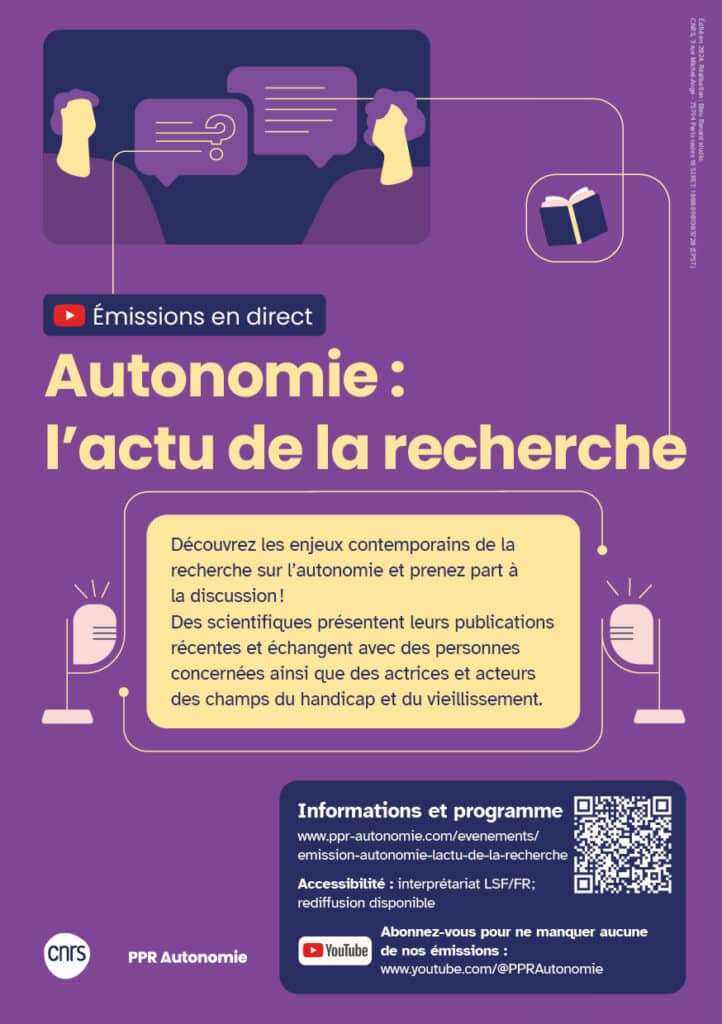
Autonomie : l’actu de la recherche
Découvrez l’actualité des publications dans le champ de la recherche sur l’autonomie en assistant à nos émissions en direct !
