Comment le handicap est-il conçu et vécu au Japon ? Les politiques publiques, les attitudes sociales et les revendications des personnes concernées y sont-elles très distinctes de celles que nous connaissons en France ? Réponse avec Anne-Lise Mithout autour de la présentation de son ouvrage Le cœur et le droit (Hermann, 2024) et en discussion avec Ivanka Guillaume et Laetitia Rebord.
Présentation du livre d’Anne-Lise Mithout

Sortir des stéréotypes sur le Japon et ses normes
Le champ de recherche des « études japonaises » se consacre à des travaux portant sur la société et la culture du Japon. Ce pays est souvent présenté comme ayant par une population très homogène et une société imposant de nombreuses normes aux individus.
Anne-Lise Mithout ne cède pas à ce prisme culturaliste et réducteur, et s’intéresse à celles et ceux qui, précisément, sortent de la norme : les personnes en situation de handicap.
Étudier la culture comme le produit d’une histoire
Comprendre la culture d’un pays nécessite de la replacer dans l’histoire. L’histoire est bien souvent politique.
C’est pourquoi Anne-Lise Mithout a choisi d’adopter une démarche sociohistorique, qui lui permet de porter un regard sur le handicap au Japon ancré dans des faits.
Des similarités avec les pays occidentaux
Au Japon comme dans de nombreux pays occidentaux – notamment la France -, la définition du handicap et sa prise en charge sont relatives à l’incapacité de travailler. Les personnes handicapées sont celles à qui on accorde le droit de ne pas travailler et qui dépendent de la charité pour vivre, celle-ci étant souvent apportée par leur famille. Aussi, le contenu des politiques du handicap et la vie des personnes handicapées japonaises ne sont pas spécifiques à ce pays.
Cœur, amour et sentimentalisme
Bien que le sentimentalisme autour du handicap existe dans d’autres pays, il est particulièrement mis en avant au Japon.
Dans la communication publique qui l’entoure, la forme du cœur et les termes évoquant l’amour sont omniprésents. Cela s’applique aux documents officiels comme la carte d’invalidité attachée au handicap mental. Le timbre qui assure la gratuité des envois postaux pour les personnes non-voyantes est appelé « le sceau d’amour des aveugles ». Les bâtiments accessibles arborent un logo en forme de cœur.
Un héritage de la charité bouddhique
Avant l’émergence de l’Etat-providence, la prise en charge publique du handicap est marqué par les institutions bouddhistes, pour lesquelles la compassion envers les plus faibles est une valeur importante. Par la suite, c’est la charité chrétienne qui s’impose, reprenant des mécanismes similaires.
Compassion et charité ont ainsi fortement imprégné les conceptions japonaises du handicap et la façon de considérer les personnes handicapées.
Famille et devoir d’assistance mutuelle
Les familles assuraient alors majoritairement la prise en charge des personnes handicapées.
C’est dans cadre que l’on faisait appel au sens du devoir d’assistance mutuelle, à travers la promotion de la valeur de l’amour familial. Les femmes ont été particulièrement visées par cet impératif et chargées de cette tache de soin.
L’eugénisme au Japon
C’est au début du 20e siècle que le Japon commence à développer une pensée eugéniste, autour de la « qualité » de la population, et dans un but de « développement de la nation » : comment produire de bons travailleurs et de bons soldats ?
La génétique est investie afin de pouvoir choisir les gènes dont il convient de favoriser – ou au contraire d’empêcher – la transmission intergénérationnelle. Cela mène à des politiques de stérilisation de personnes porteuses de maladies jugées héréditaires.
Cependant, le recours à la génétique n’est qu’une petite partie de la pensée et des politiques eugénistes. Le Japon a surtout développé des actions de modification de l’environnement, car la « qualité » de la population est associées aux conditions de vie des personnes : santé, logement, nutrition, etc.
Pour en apprendre plus sur l’eugénisme au Japon, l’ouvrage d’Isabelle Konuma Eugénisme au Japon : politiques et droit, de 1868 à 1996 (Ined, 2024) est une excellente référence.
Handicap et eugénisme
En 1940, une première loi eugéniste est promulguée. Elle comporte un volet sur la stérilisation des personnes handicapées, qui est peu mis en application pendant la guerre.
En 1948 une « loi relative à la protection eugénique » entre en application, qui revient notamment sur la stérilisation des personnes handicapées. Ces stérilisations peuvent être volontaires, mais également pratiquées de force.
Contester l’eugénisme
20 000 cas de stérilisations forcées ont été recensés, entre autre dans les institutions et sur des mineurs.
Cette loi et ses applications ont fait l’objet d’une forte mobilisation de la part des associations de défenses des droits des personnes handicapées : elle est abrogée en 1996. Des compensations ont été demandées, dans un objectif de réparation, par l’État japonais, du préjudice subi par les victimes.
Ce mouvement contre les stérilisations forcées a mis du temps à se mettre en place : il a été difficile de trouver des personnes qui acceptent de témoigner et de porter plainte, et ainsi de se déclarer publiquement comme victime pour pouvoir initier des procès.
Ce n’est qu’à l’été 2024 que la loi de 1948 a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême et qu’un plan de compensation des victimes a été proposé.
1950-1960 : un isolement par défaut
Ce mouvement de lutte contre les politiques eugénistes s’est ensuite élargi pour lutter aussi contre les discriminations envers les personnes handicapées.
Dans le Japon des années 1950-1960, de nombreuses personnes handicapées étaient confinées à leur domicile, faute de matériel et d’infrastructures leur permettant de se déplacer, mais également car leurs familles avaient parfois peur du regard de leurs voisins.
Rencontrer des pairs, politiser le handicap
Cet enfermement empêchait aussi de se côtoyer entre pairs. C’est pourquoi des associations comme Aoi Shiba no Kai ont eu pour objectif de faire se rencontrer des personnes partageant des situations similaires, de créer des possibilités d’échanges, y compris autour de questions politiques. Petit à petit, diverses formes d’action se sont développées : discussions d’idées dans des journaux et magazines, mobilisation auprès de collectivités locales pour obtenir des aides, etc.
Sortir de la « logique de l’amour »
A cette époque, la prise en charge des personnes handicapées reposant principalement sur les familles, des mobilisations ont émergé, en opposition à cette « logique du cœur ». Celle-ci rendait les enfants handicapés très dépendants de leurs parents, faisait peser une charge mentale importante sur les mères, et pouvait engendrer des situations familiales complexes.
Les associations ont lutté pour sortir de ce recours aliénant aux sentiments.
Vers la reconnaissance des droits
Les objectifs ont alors été de développer des dispositifs d’aide publics et d’obtenir la reconnaissance des droits des personnes handicapées comme citoyennes et membres à part entière de la société.
Ces luttes se sont appuyées sur l’appareil juridique, notamment la Constitution japonaise et ses valeurs : la liberté, le droit à la poursuite du bonheur, l’égalité, la non-discrimination, etc.
La mobilisation des familles
Dans les années 1950-1960, peu avant l’émergence des revendications des personnes handicapées pour leurs droits, les familles d’enfants handicapés se sont fortement mobilisées pour demander la création de meilleures institutions d’éducation et de prise en charge.
Les associations comme Aoi Shiba no Kai ont contesté ces revendications des familles, qui étaient présentées au nom de « l’amour » des parents pour leurs enfants.
Une lutte contre l’institutionnalisation
Pour les associations de personnes handicapées, l’institutionnalisation est une privation de liberté : les établissements ressemblent à des prisons et sont des lieux de maltraitance.
Loin d’être perçu comme un geste d’amour, le placement en institution traduirait l’expression de l’égoïsme des valides, qui préféraient cacher les personnes handicapées et les mettre à l’écart par une politique ségrégative.
L’éducation sous la « logique du cœur »
L’éducation, surtout celle à destination des jeunes enfants, tend à suivre la « logique du cœur » : on considère qu’il faut les aider, et cette aide passe souvent par l’institutionnalisation. Les premières écoles spécialisées étaient des œuvres de charité. Cette situation a longuement perduré pour les établissements dédiés au handicap mental : leur intégration dans le système d’éducation nationale ne s’est faite qu’en 1977.
Vers une éducation intégrative ?
C’est désormais l’éducation intégrative qui est promue : les enfants ont un droit égal à l’éducation. Cependant, le domaine éducatif est également marqué par une logique de contrôle social, qui s’exprime tout particulièrement dans le contexte du handicap mental. Cela tient notamment au fait qu’au 20e siècle, de nombreuses personnes avec un handicap mental étaient envoyées dans les prisons et les bagnes, où elles étaient éduquées à des fin de prévention de la criminalité.
Les établissements spécialisés sont propices à cette logique de contrôle, c’est pourquoi malgré une ambition intégrative, les enfants handicapés sont encore souvent exclus de l’éducation ordinaire, ceci pour qu’ils ne « perturbent » pas, par leur comportement jugé « problématique », le fonctionnement des classes.
Les limites du handicap au travail
Comme en France, il existe au Japon deux cadres d’insertion dans l’emploi pour les personnes handicapées : le travail protégé et le travail en milieu ordinaire. Les travailleurs et les travailleuses sont en général forcés de prendre des emplois peu valorisés, ou d’opter pour des formes d’emploi très précaires comme les contrats de travail « à temps très partiel ».
Le travail protégé
Le cadre du travail protégé n’offre pas aux personnes handicapées un statut de travailleur. Elles ne signent pas de contrat de travail et sont considérées comme les usagères d’un service de protection sociale. Leur salaire horaire est très en dessous du salaire minimum légal et ne peut pas dépasser ce salaire minimum. L’intérêt du travail protégé réside dans ses conditions d’organisation : flexibilité des horaires, des relations humaines, etc.
Le travail en milieu ordinaire
Travailler en milieu ordinaire permet une rémunération plus élevée, mais beaucoup de personnes handicapées y exercent à temps partiel, ce qui fait baisser l’intérêt économique de ces postes. Elles doivent se soumettre aux règles usuelles du monde du travail, même si certaines entreprises font des efforts pour se montrer plus inclusives.
Respecter le quota ?
Certains travailleurs témoignent avoir la sensation d’avoir été recrutés dans le seul but de satisfaire le quota obligeant les entreprises à embaucher au moins 2.5% de personnes handicapées : ils sont considérés avec méfiance, se voient confier peu de tâche, ou encore sont isolés du reste des employés, parfois via la création d’une filiale spéciale.
D’autres entreprises contournent l’obligation du quota en choisissant de payer l’amende.
Le « travail à temps très partiel »
Le travail « à temps très partiel » est une initiative spécifique lancée par un centre de recherche de l’Université de Tokyo, qui s’intéresse tout particulièrement aux technologies. Ces rares heures hebdomadaires effectuées en entreprise le sont par des personnes handicapées utilisant pour ce faire l’assistance technologique. Elles touchent un salaire horaire élevé, mais les quotas horaires sont trop faibles et elles ne gagnent qu’aux alentours de 60 € par semaine.
Un dispositif critiqué
Les associations de personnes handicapées estiment que le travail à temps très partiel est une initiative qui profite davantage aux entreprises – qui peuvent se vanter d’être inclusives en montrant les employés équipés de leurs appareils technologiques – qu’aux personnes recrutées. Même si elles profitent un peu de la sociabilité de l’entreprise, leur situation économique n’en est pas véritablement améliorée.
Crise du recrutement : embaucher d’autres travailleurs
Le Japon connaît actuellement un important manque de main d’œuvre, qui incite les entreprises à recruter plus de travailleurs handicapés. Cette situation, davantage que les politiques dédiées, leur offre de nouvelles opportunités professionnelles.
Table-ronde – eugénisme, intersectionnalité, lutte pour les droits : un état des lieux
Comment les politiques eugénistes japonaises sont-elles façonné les luttes des personnes handicapées, et rendu complexe la possibilité d’une convergence des luttes, notamment avec les féministes ? Comment l’eugénisme actuel se manifeste-t-il, au Japon, mais aussi en France et ailleurs dans le monde ? Quelles ont été les victoires et les limites des mouvements pour les droits des personnes handicapées ?
Autant de questions qui ont animé les échanges autour du livre d’Anne-Lise Mithout.

Ivanka Guillaume : milieux militants et féminisme
Eugénisme, avortement et féminisme
Dans les années 1970-1980, des propositions de modification de la loi eugéniste ont suggéré d’ouvrir la possibilité d’avorter en cas de malformation fœtale, tout en ôtant la possibilité d’avorter pour des raisons économiques – qui était à l’époque la cause majeure de recours à l’interruption volontaire de grossesse. Face à cette menace, des groupes féministes se sont mobilisés pour protéger le droit à l’avortement.
Eugénisme, avortement et handicap
De leur côté, les groupes de personnes handicapées comme Aoi Shiba no Kai ont perçu cette proposition de modification comme la possibilité d’une extermination in utero des personnes handicapées, dont la vie est alors considérée comme ne valant pas la peine d’être vécues. Certains militants ont adopté une position radicale, considérant l’avortement, même hors du cadre eugéniste, comme un acte égoïste.
Le point de vue des femmes handicapées
Ivanka Guillaume s’est intéressée aux positions adoptées par les femmes handicapées elles-mêmes, face à la question de l’avortement. Influencée par le mouvement pour la vie autonome et l’approche intersectionnelle qui croise les causes féministes, LGBT et afro-américaines, la militant Asaha Yuko défend dans les années 1990 une analyse portant à la convergence des luttes.
Une approche intersectionnelle limitée
La militante Yonesu Tomoko, membre du collectif féministe Women’s Lib, avait quant à elle participé dès 1982 à la fondation de l’association féministe Shiren. Cette association a développé une approche intersectionnelle afin de lier les revendications féministes à celles des personnes handicapées. Cette convergence reste complexe : si les dispositions eugéniques ont été abrogées, l’avortement n’est toujours pas un droit au Japon.
Eugénisme et démocratie
L’eugénisme, en tant que politique mise en place par des États, n’est pas seulement promu par des régimes fascistes : il se déploie aussi dans des cadres législatifs démocratiques et avalisés par des gouvernements successifs sous couvert de la défense de l’intérêt national. Les pays nordiques l’ont ainsi beaucoup pratiqué, mais également la France, qui a pour cela été condamnée à de nombreuses reprises.

Laetitia Rebord : militer contre l’euthanasie en France
Actuellement, en France, a lieu un débat autour d’un projet de loi portant sur « la fin de vie et l’aide active à mourir ». Laetitia Rebord souhaite alerter sur l’équivoque dont cette expression est porteuse : elle suggère que ce texte de loi ne concernerait que quelques personnes âgées dans leurs dernières années de vie, ce qui n’est pas le cas.
Euthanasie : un projet inquiétant
Pour elle, le terme d’« euthanasie » est davantage représentatif des risques que fait courir ce projet de loi.
Selon les militants antivalidistes comme le collectif des Dévalideuses, dont elle fait partie, il s’agit d’un projet installant l’idée que la vie avec un handicap est une souffrance insoutenable, et que la mort serait un choix plus acceptable que la mise en place de politiques permettant des conditions de vie dignes.
Le modèle canadien et ses dérives
Le Canada et son programme Medical assistance in Dying (MAID) est souvent cité comme un exemple de loi sur la fin de vie. Pourtant, à l’origine destiné aux malades en phase terminale, il a été progressivement étendu aux personnes handicapées et aux malades chroniques, qui sont toujours plus nombreuses à demander une « aide active à mourir ». Ces personnes y ont recours non pas parce qu’elles souffrent, mais en raison de leur précarité et d’un manque d’accès aux soins.
Vers l’élimination des vies indignes
Pour elle, il s’agit là de graves dérives : des choix sociaux ont été faits, qui considèrent certaines vies comme trop indignes ou trop coûteuses pour être préservées.
Le Canada n’est pas le seul pays à mettre en place ce type de politiques.
Stérilisation et contraception forcée
L’avortement thérapeutique n’est pas la seule forme d’eugénisme touchant les personnes handicapées. Si la stérilisation forcée est désormais interdite, elle reste pratiquée : de nombreuses familles demandent à ce que leurs enfants handicapés soient stérilisés. Les institutions accueillant des personnes en situation de handicap intellectuel font parfois pression sur leurs résidents pour qu’ils prennent des contraceptifs, sans leur offrir la possibilité d’un choix éclairé.
Lutte pour les droits, quel bilan ?
En 2007, le Japon a adopté la Convention de l’ONU portant sur les droits des personnes handicapées. Sur demande des associations de personnes concernées, la Convention n’a été ratifiée qu’en 2014 : il était important pour elles de commencer par mettre en œuvre, dans un premier temps, les changements législatifs.
Ce processus, bien que relativement long, a rendu efficace le recours aux institutions internationales : le Japon respecte assez fortement les recommandations de l’ONU.
Ivanka Guillaume note l’importance, pour le Japon, des alliances transnationales – notamment du Disable people network (DPI), fondé dans les années 1980 – en matière de lutte pour la reconnaissance de droits des personnes handicapées. Ces alliances permettent de produire un discours commun et de mobiliser davantage de fonds pour les luttes.
Le massacre de Sagamihara, survenu en 2016, est le produit d’une culture au sein de laquelle la pensée eugéniste est encore latente. Un ancien employé d’un établissement pour personnes handicapées a assassiné 19 résidents, et a affirmé lors de son procès que les personnes lourdement handicapées n’avaient pas de raison d’exister. Cette pensée n’est pas propre au Japon, c’est pourquoi il est important d’élaborer des alliance transnationales et transpartisanes.
Pour Laetitia Rebord, la revendication autour des droits universel permet de repositionner la question du handicap comme étant un enjeu politique.
Cependant, cette stratégie a des limites. Les droits existent sur le papier, mais ne peuvent toujours être exercés, faute d’inégalités structurelles, notamment dans l’accès aux soins et aux aides sociales.
En France, la possibilité de l’exercice des droits se heurte à une société encore très validiste.
Le cas du projet de loi sur l’euthanasie en est, pour Laetitia Rebord, un bon exemple : les voix des personnes handicapées qui s’expriment contre ce projet ne sont pas entendues, ou bien sont assimilées au seul discours conservateur émanant des organisations religieuses.
Handicap et intersectionnalité
Ivanka Guillaume rappelle que l’intersectionnalité, en plus d’être un concept très opérant, est aussi un défi politique et militant : il s’agit de créer des espaces de parole où les conflits non résolus peuvent être abordés. Du côté de la recherche, cela consiste à inclure correctement la question du handicap comme un axe d’oppression clairement énoncé. Il s’agit en effet d’un enjeu transversal, qui peut être retrouvé dans les questions de migration, de participation politique, d’urbanisme, etc.
Le rôle de la recherche
Pour Ivanka Guillaume, les chercheurs et les chercheuses qui le peuvent devraient s’engager et se situer clairement pour penser les enjeux du handicap. Ils et elles devraient également se diriger vers des recherches participatives : faire « avec » les personnes concernées, et non pas de la recherche « sur » elles.
Anne-Lise Mithout précise qu’au Japon, des initiatives importantes existent dans le domaine de la recherche impliquant les personnes concernées (Tôjisha kenkyû). Il s’agit d’amener des personnes n’ayant pas nécessairement de diplômes universitaires à faire de la recherche et à valoriser leur expertise sur les situations qu’elles vivent. Ce sont des méthodes particulièrement investies par la recherche en psychiatrie, mais aussi le handicap.
Pour Laetitia Rebord, les chercheurs et les chercheuses devraient mener davantage de travaux sur le validisme en tant qu’oppression systémique. Des recherches ont été engagées sur d’autres oppressions, notamment celles du genre ou du racisme : ces études sont toujours en nombre insuffisant, mais le validisme est encore moins étudié.
Plan 75 : La reco culture de Marianne Vigneulle
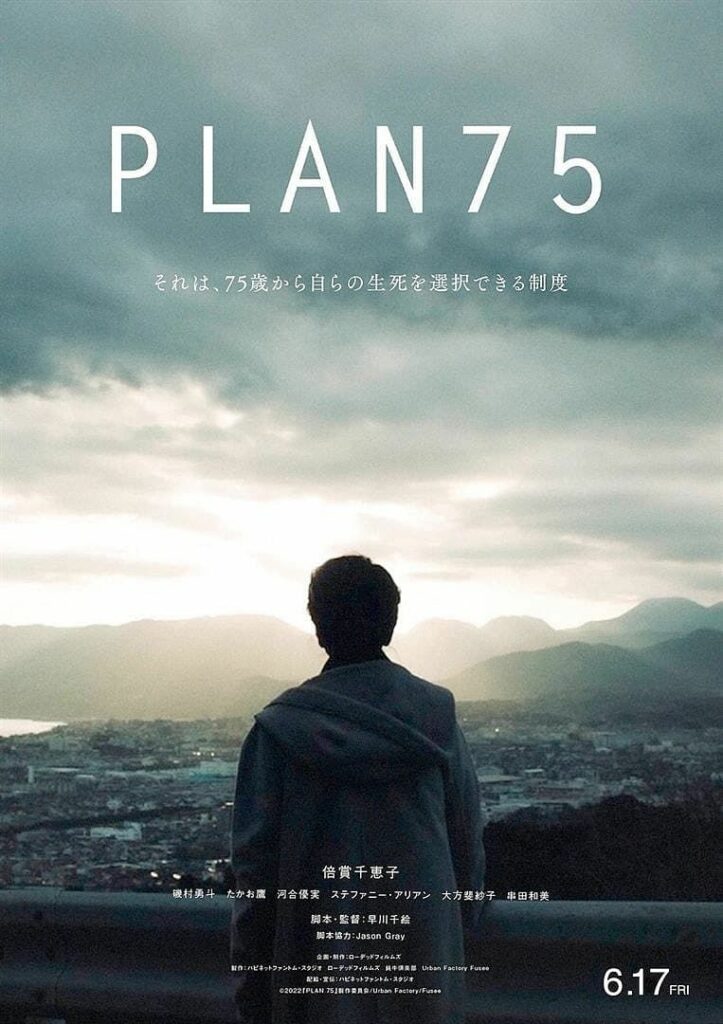
Le film Plan 75 du réalisateur Chie Hayazawa (2022) dépeint une société ayant instauré un programme de fin de vie volontaire pour faire face au vieillissement de sa population : les personnes de plus de 75 ans peuvent organiser leur mort accompagnée. Ce programme est présenté comme un progrès social – celui de la liberté de décider de son propre destin.
Pourtant, il s’agit d’une société qui pousse les plus fragiles vers le choix de la mort. Car ce n’est pas la maladie ou la souffrance physique qui incitent les « volontaires » à s’inscrire au programme, mais l’absence de perspectives : la précarité, l’isolement, un environnement dont ils se sentent peu à peu exclus. À cela s’ajoute la pression sociale à peine voilée d’une société qui considère les personnes âgées comme un fardeau économique pesant sur les nouvelles générations.
Plan 75 est le premier long métrage de la réalisatrice, qui a expliqué l’avoir tourné en écho au massacre de Sagamihara.
Réalisé dans un Japon encore marqué par son histoire eugéniste, il s’agit d’un film qui interroge la manière dont une société valorise ou marginalise ses membres en fonction de leur productivité ou de leur utilité perçue.
Découvrez l’émission et sa programmation
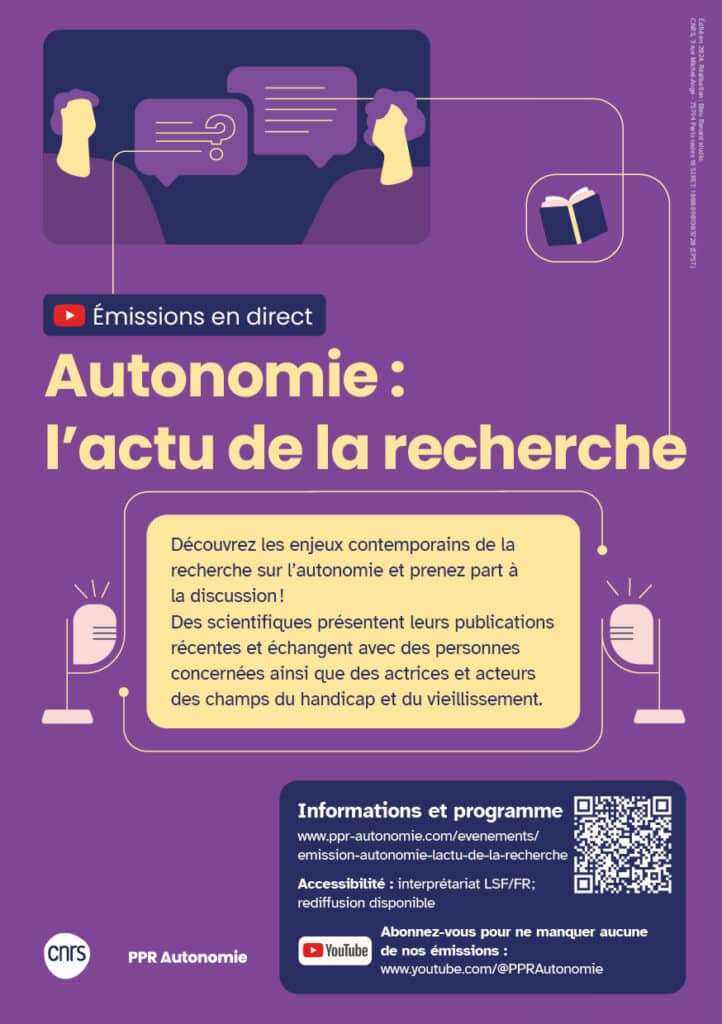
Autonomie : l’actu de la recherche
Découvrez l’actualité des publications dans le champ de la recherche sur l’autonomie en assistant à nos émissions en direct !
