Dans de nombreux pays à travers le monde, les aides à domicile exercent leur métier auprès des personnes âgées dépendantes dans des conditions difficiles, parfois extrêmes. C’est le cas en France et en Argentine, où la sociologue Natacha Borgeaud-Garciandía a mené les enquêtes qu’elle relate dans son livre Dans l’intimité du care. À quoi ressemble le quotidien de ces employées ? Comment remettre le care au cœur de nos sociétés vieillissantes ?
Présentation de l’ouvrage Dans l’intimité du care, par Natacha Borgeaud-Garciandía

Enquêter sur le travail de care
Natacha Borgeaud-Garciandía cherche à mieux comprendre les relations propres au travail de care et le rapport qu’entretiennent les travailleuses du care à leur emploi.
Pour ce faire, elle a enquêté auprès de différentes populations d’aidants rémunérés – notamment en menant des entretiens en France avec des aides à domicile, et en Argentine avec des travailleuses ayant suivi des cursus publics de formation aux tâches de care à domicile de personnes âgées.
Les travailleuses du care argentines
Le cœur de l’enquête porte sur les travailleuses du care en Argentine vivant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et six jours sur sept auprès de personnes âgées en perte d’autonomie. Elles les accompagnent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ces employées sont souvent des migrantes qui parviennent à s’insérer sur le marché du travail des grandes villes en prenant ce type de poste. Certaines se spécialisent et parviennent ainsi à construire des carrières professionnelles sur le long terme.
De l’extrême à l’ordinaire
Les migrantes, qui sont des subalternes, acceptent les emplois que les travailleurs et travailleuses argentines ne souhaitent pas occuper, car ils offrent des conditions de travail très difficiles.
Pour Natacha Borgeaud-Garciandía, mettre en lumière ces situations extrêmes d’accompagnement des personnes âgées permet de mieux comprendre ce qui se joue dans des expériences plus courantes et que l’on ne remarque plus, car nous les jugeons ordinaires – par exemple, l’expérience des proches aidants.
Le rapport subjectif au travail
L’expérience du travail, quel qu’il soit, implique la subjectivité des personnes et la transforme : elle engage le corps et l’intelligence émotionnelle.
Cela est encore plus important lorsqu’il s’agit de prendre en charge des personnes vulnérables, ce qui implique un contact direct de l’autre et avec son corps, sans médiation. Ce travail exige des compétences physiques et relationnelles, mobilisées dans des situations concrètes.
Prendre soin, faire exister
Les personnes âgées dont ces travailleuses s’occupent sont souvent atteintes de troubles cognitifs et sont très dépendantes. Elles ont de nombreux besoins, qui ne sauraient se résumer à être nourries et lavées.
Ces gestes pratiques s’inscrivent dans une relation intersubjective. Ils sont porteurs d’une signification importante pour la personne dépendante – celle de leur propre existence.
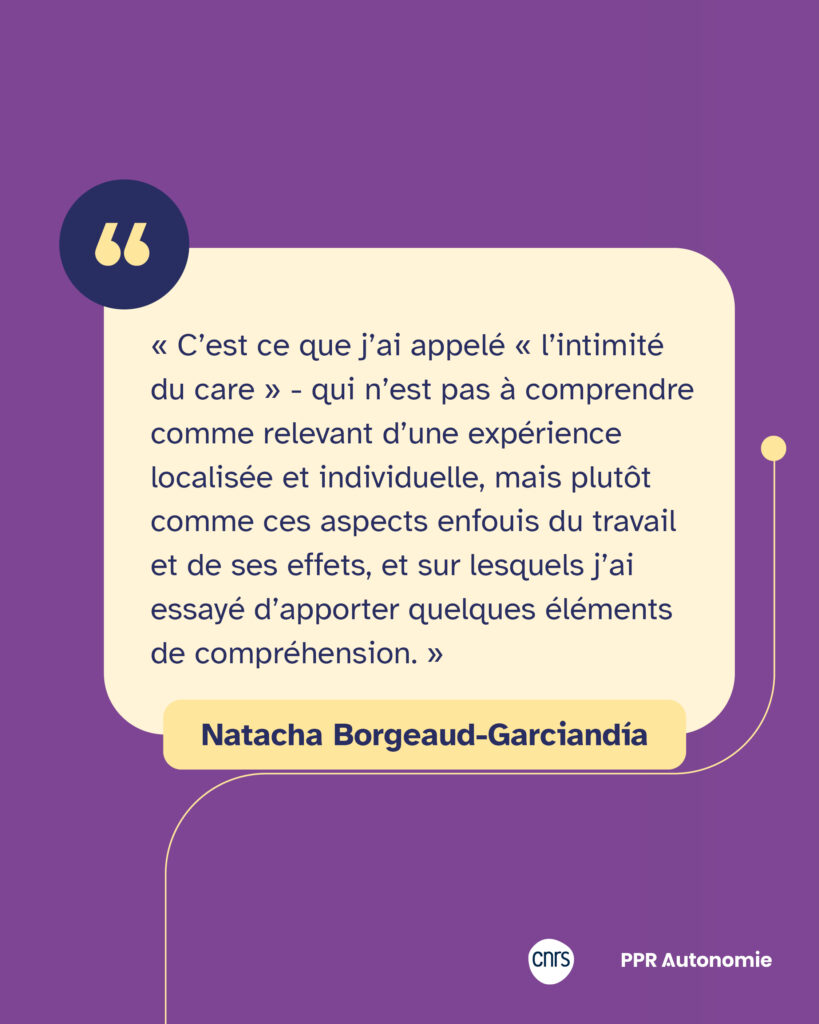
Arriver dans un nouveau domicile
Lorsqu’une aidante professionnelle commence un nouvel emploi, elle découvre et s’installe dans un nouveau lieu de vie. Elle doit y trouver ses marques rapidement et se faire accepter par la personne âgée qui dépend d’elle, mais qui peut refuser sa présence et ses soins.
La famille, qui se sent souvent coupable d’imposer une aide à domicile à son proche en perte d’autonomie, peut également rendre la prise de poste complexe.
Le travail de la relation
Une part essentielle du travail de care consiste en un « travail de la relation » – un travail de l’aidante sur ses propres émotions ainsi que sur celles de la personne âgée. Cela lui permet de créer des conditions de travail sereines et maîtrisées. Il lui faut pour cela connaître finement la personne, les effets de sa maladie, sa famille et leurs rapports interpersonnels.
Ainsi, elle peut se préserver des effets délétères d’un emploi dans ces conditions extrêmes.
Une législation peu appliquée
La législation argentine portant sur les emplois domestiques impose des temps de repos, en particulier lorsque les travailleuses vivent à domicile.
Cependant, aucun contrôle n’est effectué quant au respect de ces temps, qui sont par ailleurs incompatibles avec les caractéristiques propres aux emplois de care et aux responsabilités qu’ils impliquent.
Quand la dépendance s’accroît
Lorsqu’une employée arrive auprès d’une personne qui garde une certaine autonomie et peut encore demeurer ponctuellement seule, l’aide à domicile peut s’absenter – pour faire une course, visiter une voisine ou faire une promenade – et il est aussi possible de sortir à deux pour prendre l’air. Ce sont autant de moments essentiels pour préserver son équilibre au travail. Quand la dépendance s’accroît, le temps et l’espace de vie et de travail de l’employée se resserrent jusqu’à ne faire plus qu’un, lui donnant un fort sentiment d’enfermement.
Tenir face à une situation de travail extrême
Quand le contexte de travail se rétrécit pour suivre jour et nuit la temporalité et les aléas de la maladie et de la dépendance, les aides à domicile mettent en place des mécanismes leur permettant de faire face. Une enquêtée raconte qu’elle vide et range entièrement son armoire chaque jour, une autre dit profiter de ses insomnies pour en faire des moments où elle peut être seule avec elle-même.
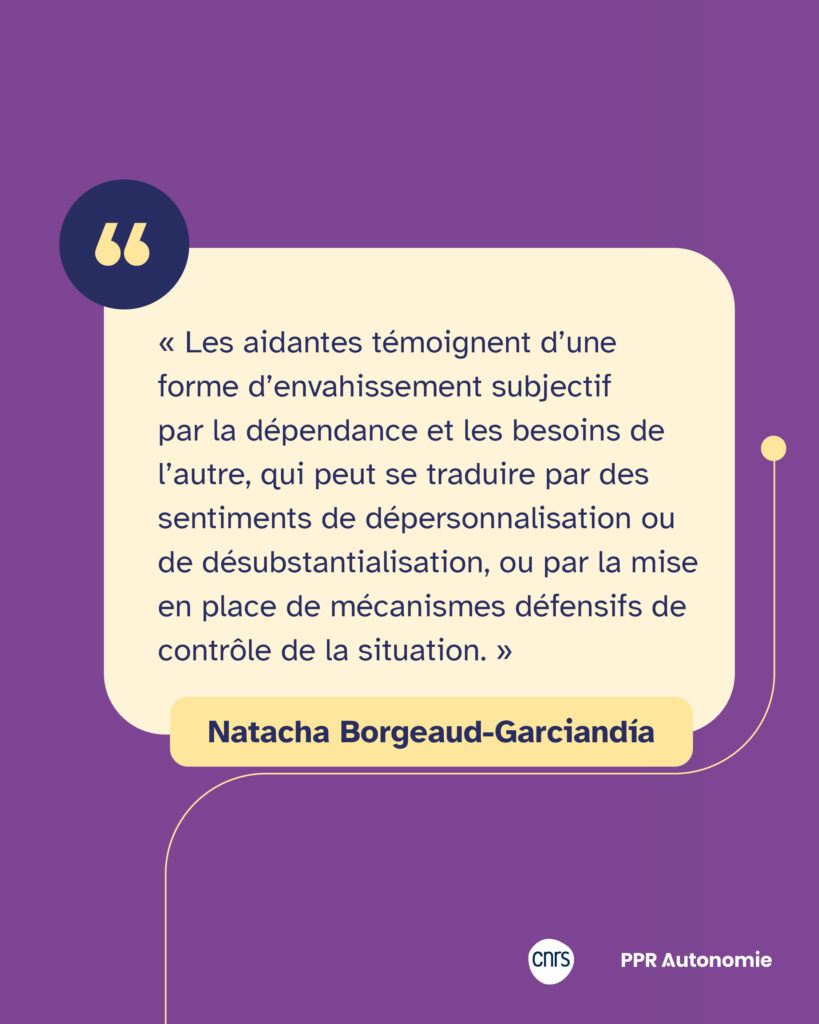
Au contact du corps de l’autre
Les aides à domicile, dans leur travail quotidien, sont au contact avec le corps de l’autre dans sa dimension intime : elles le manipulent, notamment pour faire la toilette de la personne. Ces gestes ont sur elles un impact affectif, car le corps est habité, et sa « déchéance » renvoie les aidantes au devenir de leur propre corps. Les soins du corps représentent un défi, tant pour la personne âgée qui doit accepter d’être vue, touchée et assistée, que pour les aidantes qui doivent se faire accepter comme telle tout en surmontant et en contrôlant leurs propres émotions.
Domestiquer la peur et le dégoût
Dans les entretiens, les aides à domicile ont évoqué leurs premières expériences de confrontation avec l’intimité du corps de l’autre : elles disent avoir ressenti de la peur, du dégoût, ou encore l’envie de fuir. Afin de pouvoir travailler, elles développent des stratégies de domestication de ces émotions. Elles peuvent, par exemple, se référer à une expérience antérieure de soin dans le cadre familial, faire passer leur propre malaise après celui de la personne aidée en s’occupant de la réconforter, décrire le contact avec le corps de manière clinique, etc.
Construire le travail de care
Ces stratégies de contrôle des émotions permettent également de construire le travail de care.
Comprendre les besoins de la personne âgée en l’impliquant, surmonter ensemble les difficultés du soin porté au corps et à ses déjections : cela donne à ces gestes de nouvelles significations, en fait un aspect essentiel de l’accompagnement.
Accompagner les troubles cognitifs
Les difficultés de la relation de care sont décuplées lorsque les personnes accompagnées sont affectées de troubles cognitifs. Ceux-ci peuvent se manifester par des pertes de mémoire et des troubles du comportement qui mènent parfois les personnes à être violentes physiquement et verbalement, ou encore à pleurer ou être apathiques.
Lorsque la personne âgée ne répond plus aux codes sociaux et interpersonnels habituels, il est encore plus complexe d’anticiper la façon dont va se dérouler un soin.
Faire le « sale boulot » ?
Le travail de care comporte toutes les caractéristiques de ce qu’on qualifie de « sale boulot » : c’est un emploi dévalorisé et subalternisé, impliquant d’être en contact avec la saleté.
Pourtant, les aides à domicile ne le présentent pas ainsi : elles y voient la possibilité de se consacrer complètement à autrui et ne distinguent pas des activités qui seraient plus nobles que d’autres. Aussi, le sale n’est pas considéré comme tel, et sa gestion est perçue comme contribuant au bien-être de la personne prise en charge.
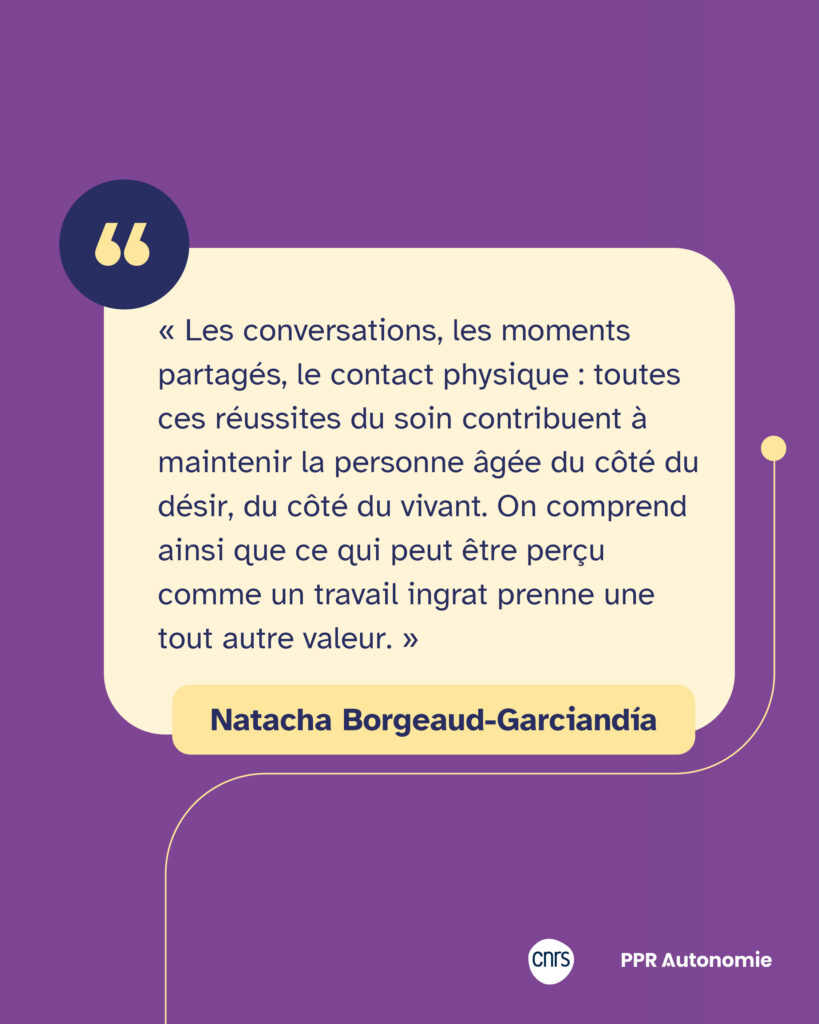
Un travail invisible
Lorsqu’on voit une personne âgée dépendante propre et bien soignée, rien n’indique les difficultés rencontrées et les efforts minutieux, l’ingéniosité que les aides à domicile ont dû déployer pour les surmonter et parvenir à ce résultat.
Pour la psychologue Pascale Molinier, le travail de care se caractérise en effet par son « invisibilité » : il est effectué au sein des domiciles et des institutions et consiste à anticiper le besoin des personnes avant qu’il ne se manifeste.
Une expérience inaudible
Pascale Molinier explique également que l’expérience du travail de care est « inaudible », car les récits en sont faits ne décrivent pas des activités aisément généralisables. Il ne s’agit pas d’effectuer un ensemble de tâches bien établies, mais de parvenir à les réaliser avec les personnes qui en bénéficient, en étant à leur écoute.
Des gestes qui peuvent paraître banals (prendre un bain, un repas, marcher, éviter une angoisse, etc.) deviennent des défis à surmonter avec patience, et sont de grandes victoires lorsqu’ils sont accomplis.
Les ambiguïtés du care
Les aides à domicile considèrent leur activité auprès des personnes âgées dépendantes comme essentielle, s’y reconnaissent et s’affirment malgré le stigmate social qui y est associé.
Cependant, cette valorisation de soi se fait également à travers un travail qui est pour elles une source d’exploitation : il est donc complexe pour elles de remettre en question leur emploi sans que cela ne vienne en même temps ébranler leur identité d’aidante.
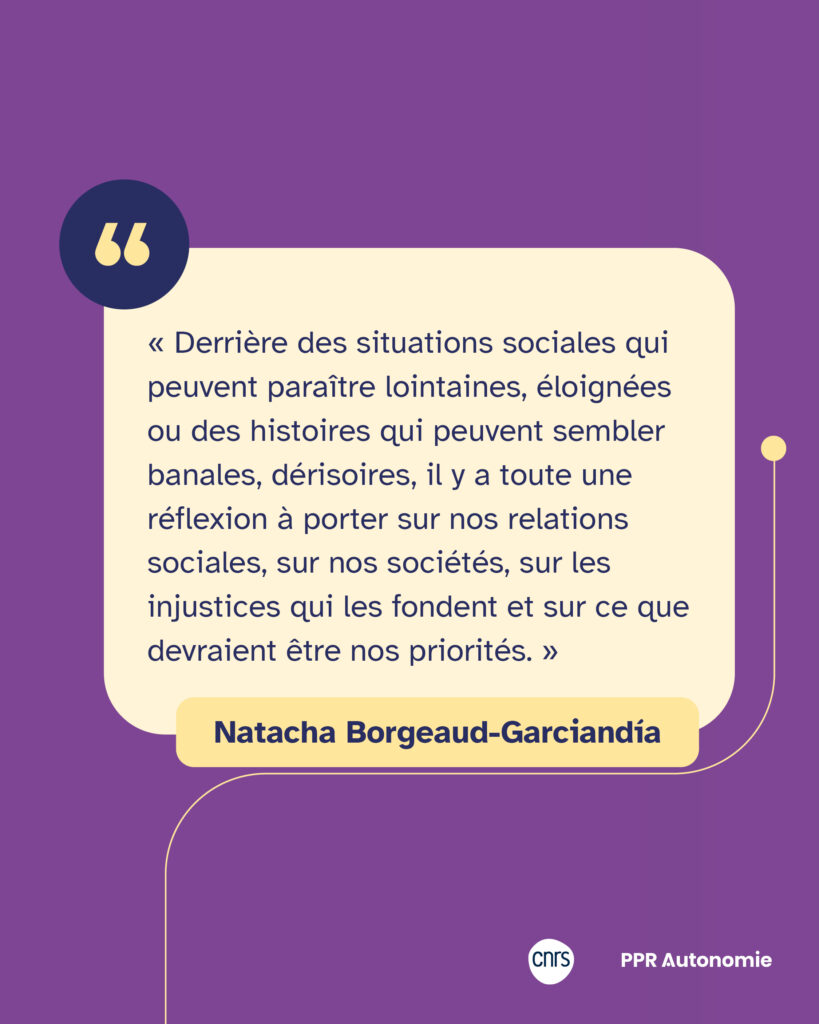
Table ronde — Repenser la place du care
Les aides à domicile, en France et à l’international, exercent leur profession dans des conditions difficiles.
Comment améliorer la situation de ces travailleuses et travailleurs du care et, ainsi, permettre aux personnes dépendantes de bénéficier d’une prise en charge adaptée ? Quel rôle la recherche scientifique pourrait-elle jouer, au côté des luttes syndicales et des réformes de l’assistance sociale ? Existe-t-il déjà des solutions qui pourraient inspirer des changements, en France et ailleurs dans le monde ?
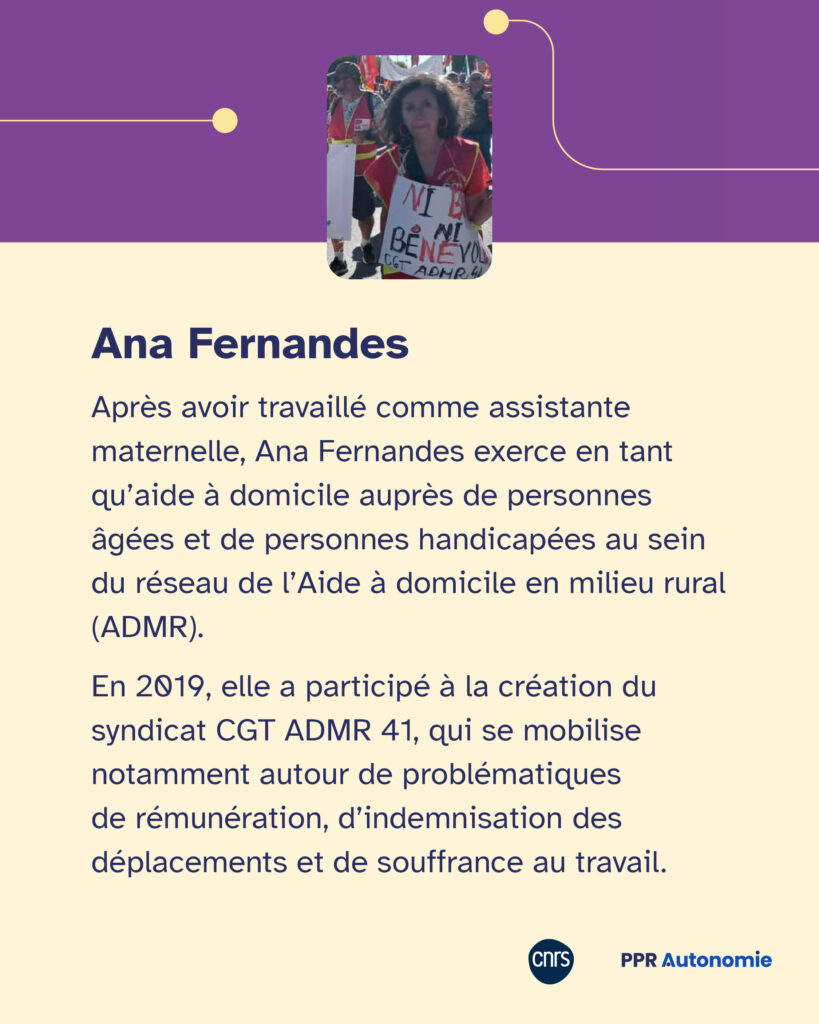
Ana Fernandes
Crise Covid et aides à domicile
Lorsque la crise de la Covid-19 a éclaté, les aides à domiciles ont été mises en lumière et la société a pris conscience du caractère essentiel de leur travail auprès des personnes âgées dépendantes.
Confrontées au manque de moyens pour exercer leur emploi, ces travailleuses se sont mobilisées pour faire entendre leurs revendications – notamment en entrant en contact entre professionnelles grâce aux réseaux sociaux.
Des revendications ignorées
Malgré ce bref moment de reconnaissance sociale, les revendications des aides à domicile n’ont pas été entendues. L’importance de leur travail est à nouveau ignorée.
C’est pourquoi les luttes qu’elles mènent portent toujours sur les mêmes problématiques. Elles dénoncent notamment un manque de valorisation et de reconnaissance de leurs activités, des salaires bas, des emplois à temps partiel, des frais de déplacement non remboursés, de la souffrance au travail.
Les glissements de tâches
Les aides à domicile sont amenées à effectuer des tâches qui sont ordinairement attribuées à des aides-soignantes, mais elles ne touchent pas les salaires plus élevés qui sont alloués à ces postes. Cela permet aux employeurs de faire des économies sur les salaires tout en contournant la problématique du manque de main-d’œuvre formée au médical. Souvent en situation de grande précarité, les aides à domicile n’ont pas d’autre choix que d’accepter ces tâches imposées par l’employeur et de travailler jusqu’à l’épuisement.
Payer pour travailler
Les faibles salaires, associés aux coûts de déplacement importants pour aller de domicile en domicile (essence, usure de la voiture), mènent les employées à perdre de l’argent en allant travailler. De plus, dans un contexte rural où les domiciles visités sont très éloignés les uns des autres, les temps de trajets sont décuplés. Face à ces emplois qui, en plus d’être peu valorisés, sont très faiblement rémunérateurs et ne permettent pas de vivre, nombreuses sont les salariées à démissionner rapidement. Les employeurs, quant à eux, peinent à recruter de nouvelles travailleuses.
La multiplication des accidents
Arriver dans un nouveau domicile est un moment particulièrement difficile pour les aidantes : elles découvrent la situation sur place le premier jour et doivent s’adapter rapidement pour parvenir à y effectuer les tâches requises. Très isolées, elles ne peuvent pas compter sur le soutien d’un tiers. Leurs compétences et leur expérience sont alors primordiales pour parvenir à effectuer l’ensemble de leurs missions de la journée en toute sécurité. Aussi, le fort turn over des employées fait augmenter le nombre d’accidents du travail et met en danger des personnes âgées.
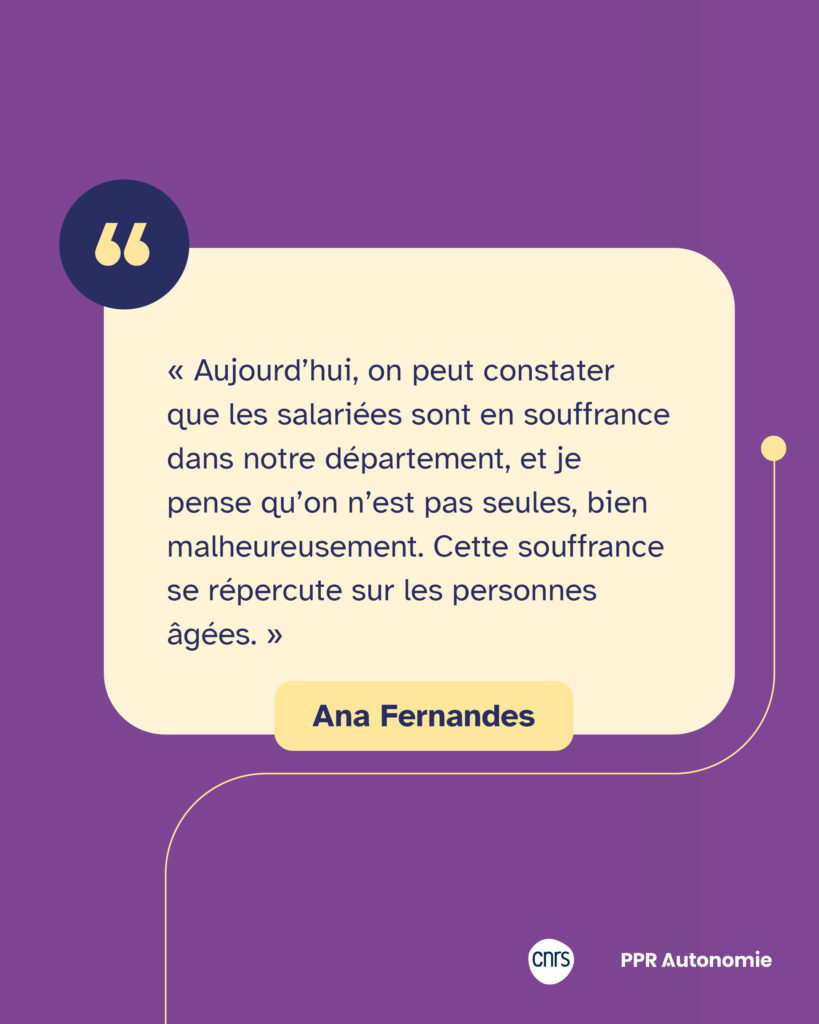

Helena Hirata
Une dévaluation internationale
Dans de nombreux pays à travers le monde, les employés du care touchent des salaires bas et disent estimer que le travail qu’ils effectuent, impliquant de grandes responsabilités et un investissement émotionnel fort, n’est pas rémunéré à sa juste valeur.
La valorisation symbolique et monétaire des métiers du care est un enjeu international.
![Encart citation : « Les gens mourraient, s’il n’y avait pas des aides à domicile attentives tous les jours à leur santé pour pallier à leur dépendance. […] Pourquoi un métier dont dépendent la vie et la mort des personnes n’est pas valorisé et compensé à sa juste valeur ? » Helena Hirata](https://ppr-autonomie.com/wp-content/uploads/2025/11/cit_6-819x1024.jpg)
Domicile unique, domiciles éloignés
La situation des aides à domicile en Argentine, étudiée par Natacha Borgeaud-Garciandía, est particulière, car les travailleuses exercent toute la semaine chez le même bénéficiaire.
En France et au Japon, pays davantage touchés par la marchandisation des métiers du care, les aides à domicile multiplient les déplacements de domicile en domicile – en voiture en France, souvent en vélo au Japon.
Le cas japonais
Les Japonais étant peu attirés par les emplois d’aide à domicile – et plus généralement par les emplois du care -, ceux-ci sont occupés par des migrants venus du Vietnam, d’Indonésie, de Thaïlande ou encore de Turquie. En outre, beaucoup d’hommes occupent ces postes : ils sont aujourd’hui en majorité dans certains établissements. La société japonaise étant vieillissante (environ 30 % de la population japonaise a plus de 65 ans), le soin aux personnes âgées est considéré comme une profession d’avenir.
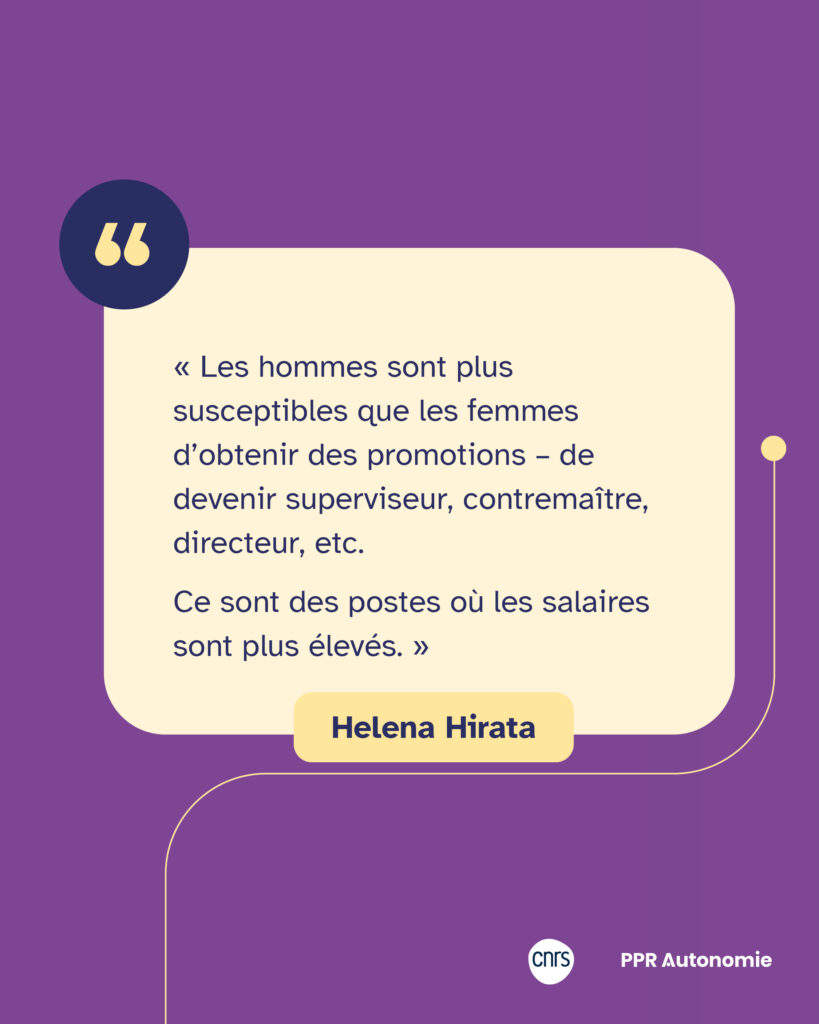
Un impact encore incertain
Au Japon, les hommes se sont tournés vers le secteur du care suite à la crise de 2008 et au fort taux de chômage qu’elle a provoqué. Ils ont préféré prendre des emplois jugés « féminins », où la main-d’œuvre manque, plutôt que d’être associés au stigmate social du chômage, très fort au Japon. L’entrée des hommes dans le secteur du care pourrait apporter des changements importants comme la hausse des salaires et l’amélioration des conditions de travail. Ces évolutions, si elles sont possibles, restent à observer et accompagner.
Une double dévalorisation
Helena Hirata explique que, selon la sociologue Patricia Paperman, les personnes âgées – mais aussi et plus généralement les enfants, les malades et les personnes en situation de handicap – sont dévalorisées du fait de leur dépendance, et que cela se répercute sur les travailleuses du care qui les prennent en charge, notamment sur leurs salaires. En outre, les femmes s’étant longuement occupées des personnes dépendantes gratuitement, l’attribution d’un faible salaire aux tâches de care est considérée comme étant déjà bien suffisante.
Mettre le care en lumière
Pour Natacha Borgeaud-Garciandía, afin de lutter contre la dévaluation du travail de care et de celles et ceux qui l’exercent, il convient de l’extraire des marges où il est relégué par crainte de la « déchéance » du vieillissement avec Alzheimer. Il s’agirait de le mettre en lumière en faisant davantage porter la voix de ses praticiens et praticiennes.
Il est également important de créer des leviers pour mieux répartir les tâches de soin au sein des sociétés, pour qu’elles ne soient plus assurées seulement par les femmes et les populations sulbalternisées en général.
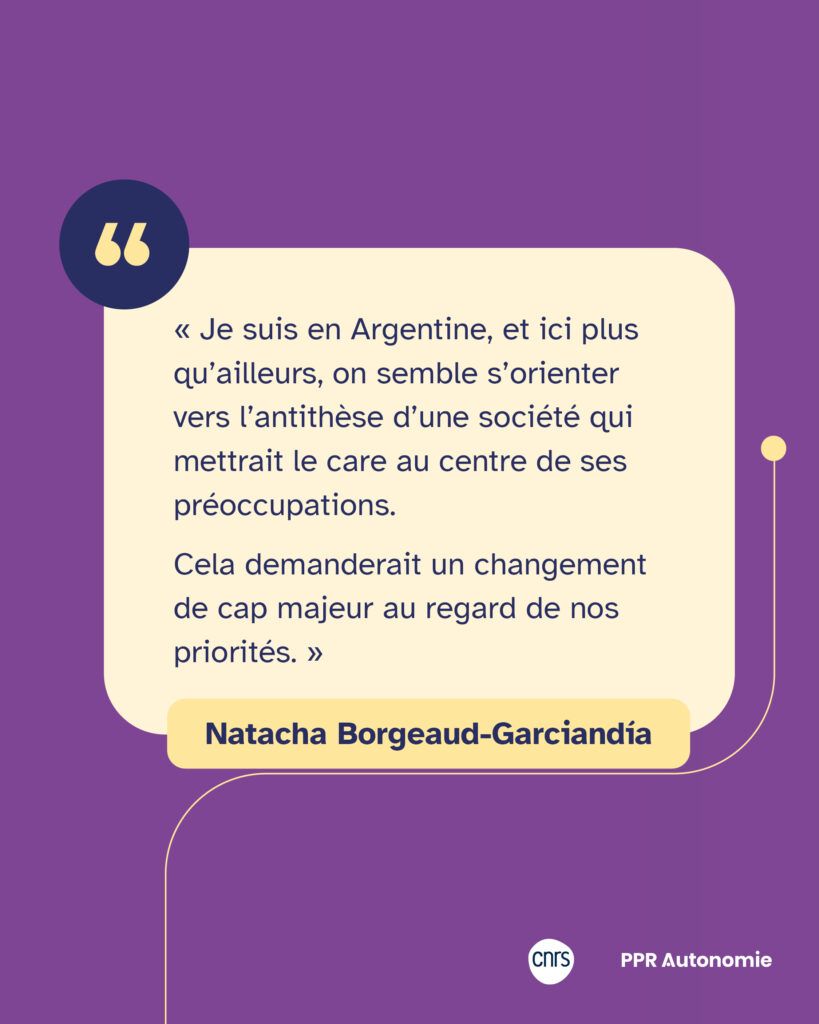
Aides à domicile : un besoin de santé
Pour Ana Fernandes, davantage d’argent public devrait être investi dans la santé, et les aides à domicile devraient relever de ce secteur. Leurs activités devraient être prises en charge au même titre que celles des aides-soignantes, afin que toutes et tous puissent, lorsque cela devient nécessaire avec l’âge, bénéficier des services des aides à domiciles.
Revaloriser les salaires
Pour Ana Fernandes, les bas salaires sont un repoussoir majeur, tant pour les hommes que pour les personnes migrantes et les personnes précaires qui pourraient souhaiter investir les emplois d’aide à domicile.
Lutter malgré les risques
Anna Fernandes note que l’isolement des aides à domicile rend difficile toute action collective. En outre, les employeurs refusent que les représentants du personnel informent les salariées à propos de leurs droits. Les salariées, quant à elles, craignent de se tourner vers les syndicats, par peur d’être sanctionnées.
C’est pourquoi lorsque des grèves sont entamées, peu de personnel se mobilise. La lutte est pourtant indispensable, malgré les risques qu’elles comportent pour des travailleurs précaires, afin de faire entendre les revendications.
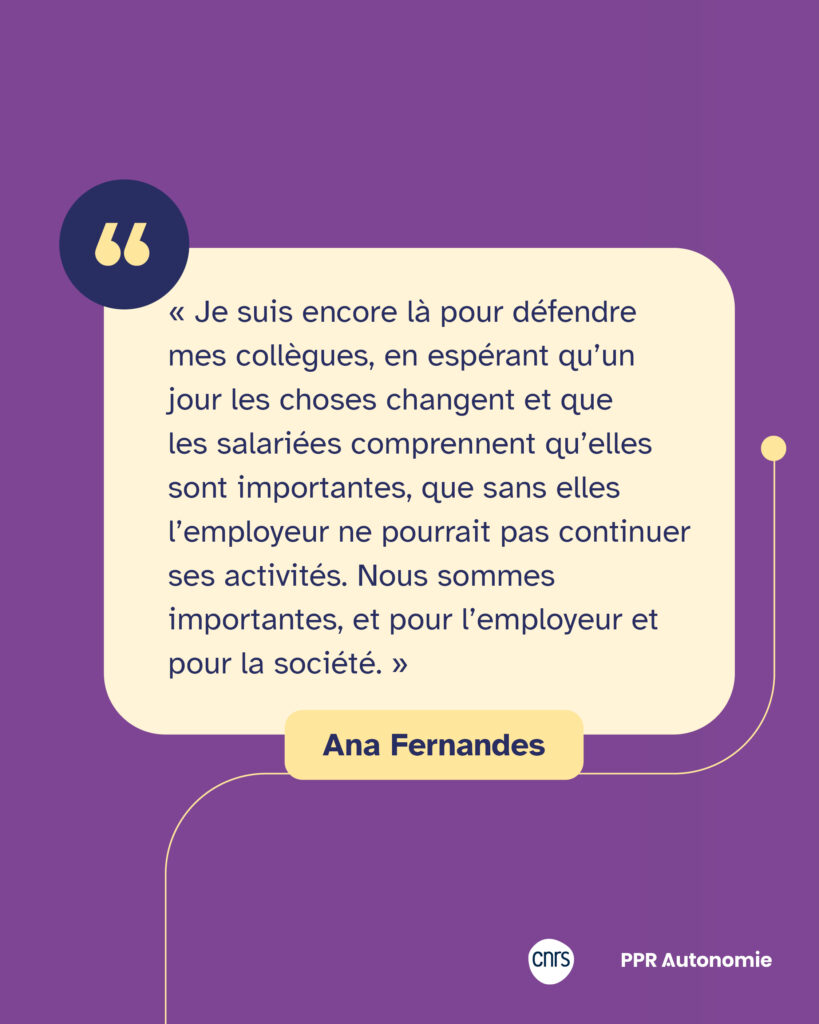
Le care au cœur en Uruguay
Natacha Borgeaud-Garciandía explique que l’Uruguay a développé un système intégré et articulé de care, qui en fait le quatrième pilier de la protection sociale – au même niveau que l’éducation ou la santé. Ce système tente de prendre en compte, à partir de mécanismes concrets, les particularités du care et sa distribution entre l’État, le marché, les associations, les familles, les hommes et les femmes. Cette démarche est complexe, mais elle relève d’une décision politique issue d’une concertation entre les acteurs de la société civile et le monde de la recherche scientifique.
Financer le care au Japon
Helena Hirata précise qu’au Japon, les prestations sociales attribuées aux personnes âgées en perte d’autonomie sont nettement plus élevées qu’en France (1711 euros en France pour l’allocation la plus élevée, contre 2671 euros au Japon). Il existe en effet au Japon un « impôt sur le care », prélevé sur les salaires des travailleurs et travailleuses entre 40 et 65 ans. Elles peuvent ainsi bénéficier de la long term care insurance (équivalent de l’APA en France), l’État prenant en charge 90% des dépenses liées à la dépendance, à domicile ou en institution. Cette mesure a été étendue aux résidents étrangers.
Améliorer les liens sciences-société
Helena Hirata précise qu’elle fait de la sociologie critique, c’est-à-dire un travail de recherche visant à permettre la transformation de la réalité. Les sociologues critiques ont en commun avec les mouvements syndicaux de souhaiter cette transformation sociale – notamment par l’amélioration des conditions de travail. Même si syndicalistes et scientifiques ont des méthodes d’action différentes, il est important de diffuser davantage les savoirs issus de la recherche auprès des militants, et que les scientifiques connaissent davantage les réalités du travail de care.
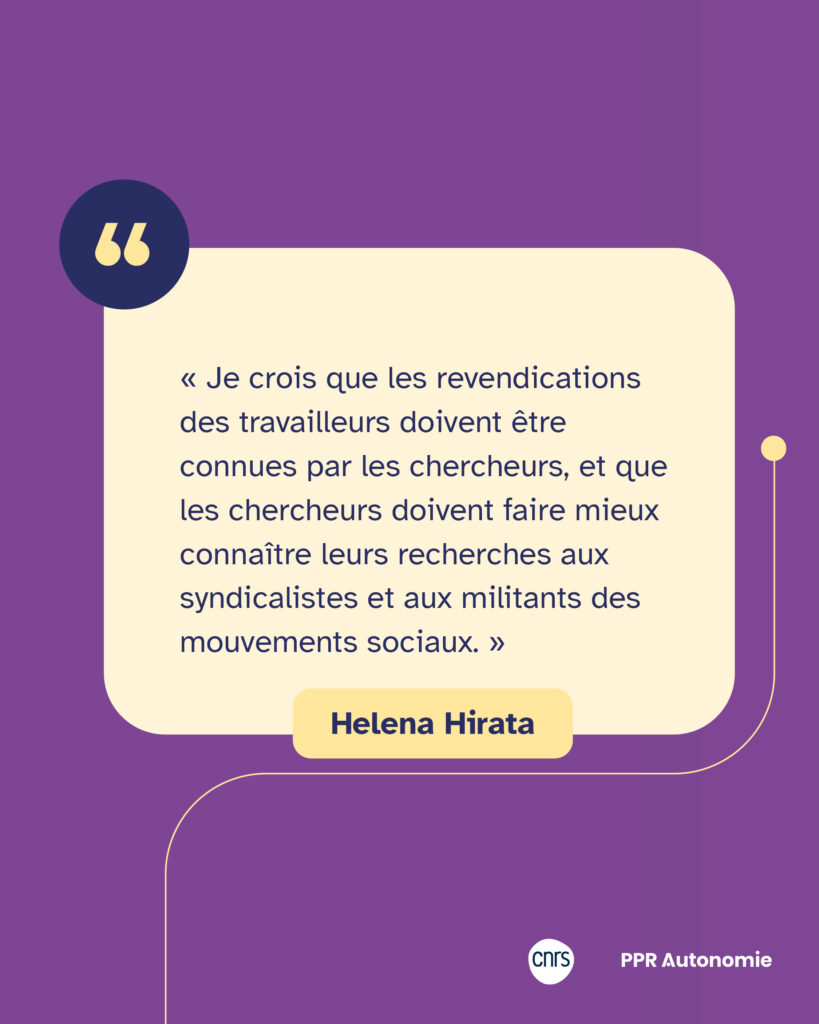
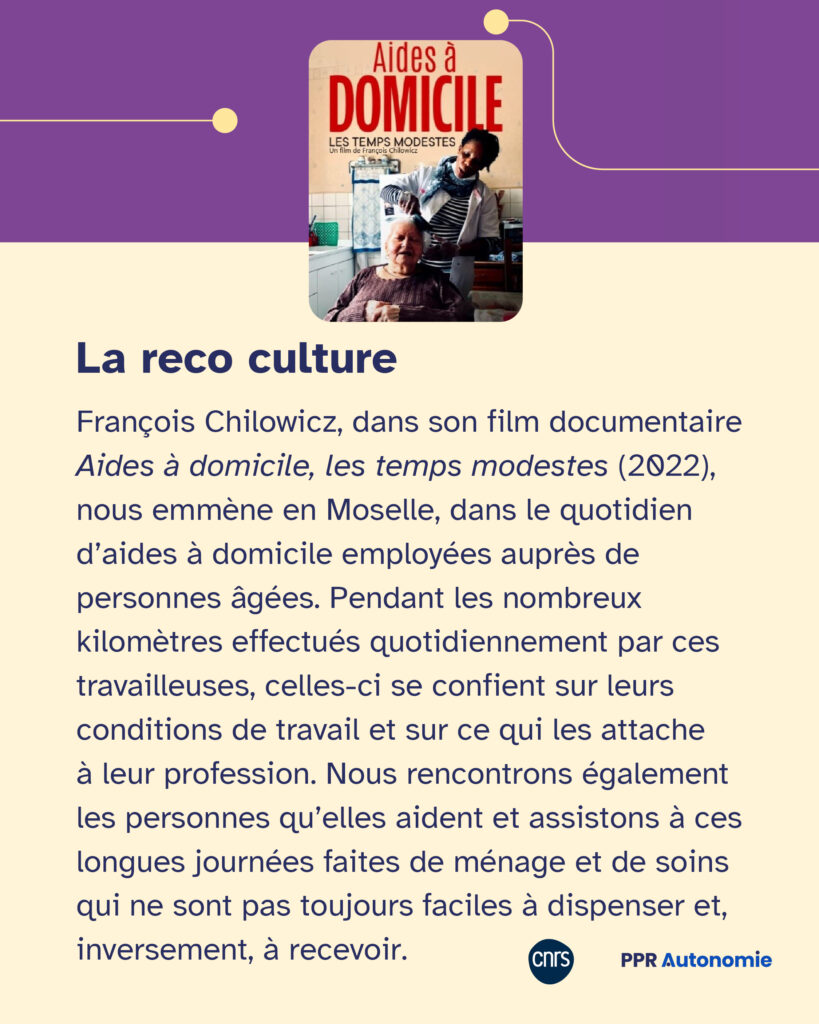
Découvrez l’émission et sa programmation
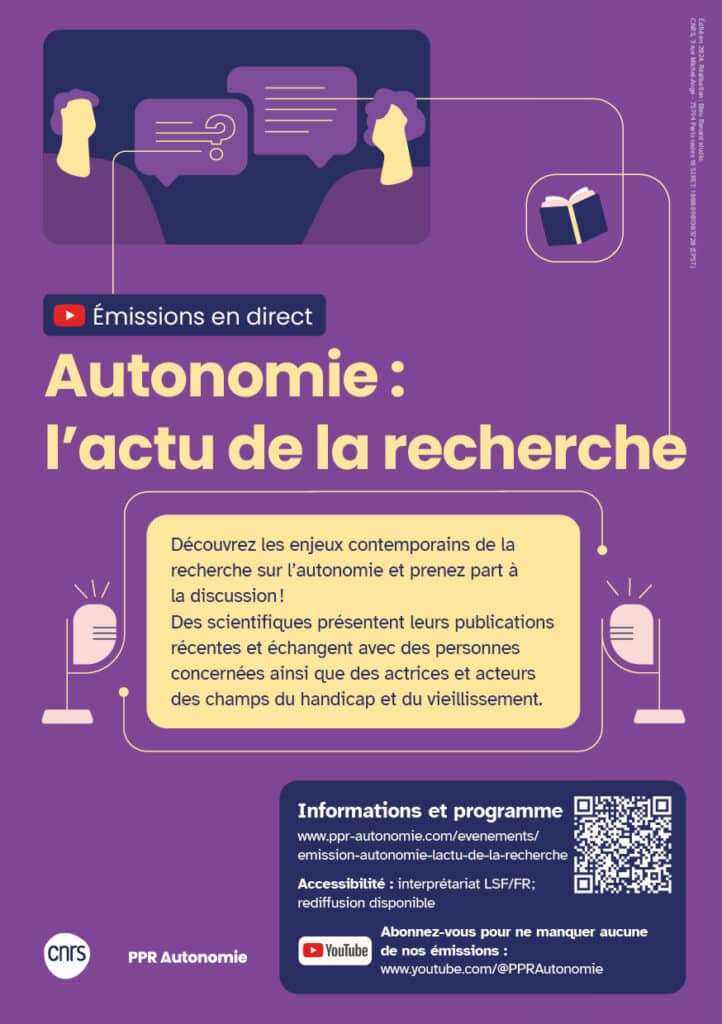
Autonomie : l’actu de la recherche
Découvrez l’actualité des publications dans le champ de la recherche sur l’autonomie en assistant à nos émissions en direct !
